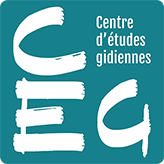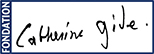Un Centre dédié à la recherche sur André Gide
Le Centre d’Études Gidiennes a vocation à coordonner l'activité scientifique autour de Gide, diffuser les informations relatives aux manifestations gidiennes et à rendre visibles et accessibles les études qui lui sont consacrées.
Nous trouver
Centre d’études gidiennes Bureau 49, bâtiment A UFR Arts, lettres et langues Université de Lorraine Île du Saulcy F-57045 Metz cedex 01Nous écrire
Stephanie Bertrand Jean-Michel Wittmann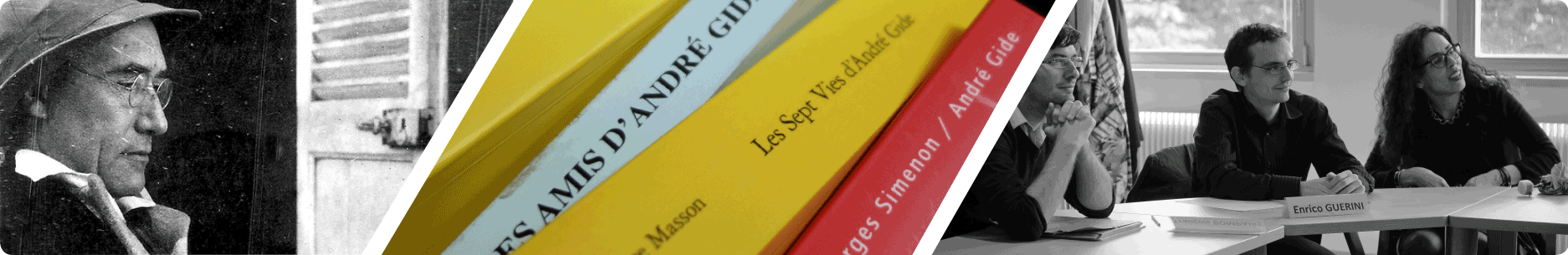
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Petit Pierre, « Tuberculose et sensibilité chez Gide et Camus. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 51, juillet 1981, p. 279-92.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Masson Pierre, « Du bon usage d'Arthur Cravan : une page inédite d'André Gide. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°167, juillet 2010, p. 287-294.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Debard Clara, « La collaboration artistique entre André Gide et Jacques Copeau. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 177/178, janvier-avril 2012, p. 99-112.
Claude Jean, « Portrait de Jean Schlumberger d'après sa correspondance (inédite) avec Jacques Copeau. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 139, juillet 2003, p. 357-372.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette oeuvre. Elles figurent en couleur.
Foucart Claude, « Lecture de l'œuvre gidienne par René Crevel. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°133, janvier 2002, p. 69-78.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette oeuvre. Elles figurent en couleur.
Dès l’adolescence de Gide, et jusqu’à sa mort, Chopin fut pour l’écrivain un compagnon de route : Gide fit du compositeur son alter ego, et conversa sans discontinuer avec lui, afin de mieux comprendre quelles pouvaient être les lignes de force de sa propre esthétique. Cette admiration pour Chopin trouve à s’exprimer à maintes reprises, dans le Journal, dans les lettres, et bien sûr dans les Notes sur Chopin (1931). Pour Gide, Chopin est l’incarnation même de l’artiste, et plus précisément de l’artiste classique. Toutefois, s’il le classe dans la famille des esprits qui révèrent la beauté plutôt que la passion, Gide considère surtout le compositeur comme un artiste incomparable. Seuls deux créateurs peuvent à ses yeux être véritablement rapprochés de Chopin, justement parce qu’eux aussi sont irréductibles : Baudelaire, et lui-même, André Gide. Il aime en effet à associer Baudelaire à Chopin : c’est que, selon lui, ils sont l’un comme l’autre antiwagnériens. En outre, tous deux furent jugés malsains – la mère de Gide interdisant même à son fils la fréquentation des pièces de Chopin. Enfin, Chopin et Baudelaire sont pareillement victimes d’interprètes-virtuoses à qui la délicatesse est étrangère.
La question de l’interprétation de l’œuvre de Chopin est centrale dans la production de Gide musicographe : Gide semble ne faire confiance qu’à sa propre subtilité pour jouer Chopin. Certes, il se souvient avec émotion des quelques œuvres de Chopin qu’il a pu entendre par Anton Rubinstein et par Ignacy Paderewski ; certes, il crédite le Père Abbé du Monte Cassino d’une compréhension profonde (car silencieuse) du compositeur ; et certes, dans les années 1940, il poussera Maurice Ohana à aborder Chopin. Néanmoins, convaincu que des pianistes tels qu’Alfred Cortot ou Arthur Rubinstein passent à côté de ce que les pièces de Chopin ont de plus précieux, Gide n’est pas loin de se rêver en prophète unique de l’esthétique chopinienne.
Aussi bien Gide semble-t-il éprouver la tentation de s’identifier à Chopin. Dès 1894, le nom de Chopin figure dans la liste des personnalités dont Gide estime que s’est formée la sienne. Et l’écrivain se plaît à comparer l’esthétique pianistique qu’il défend quand il joue Chopin à sa poétique scripturale : il dit ainsi pratiquer en littérature le legato, usage pianistique qu’il a appris à maîtriser en travaillant Chopin. À quoi il faut ajouter, au-delà de l’esthétique, une valeur éthique qui apparaît centrale dans le discours que Gide tient à la fois sur l’œuvre de Chopin et sur ses propres livres : l’intimité. Son Chopin, Gide ne parvient que très rarement à le rendre public : il peine à demeurer lui-même, et à rester fidèle à Chopin, dès lors qu’il joue pour un auditoire. Sans doute est-ce que l’artiste, qu’il se nomme Frédéric Chopin, Charles Baudelaire ou André Gide, n’est authentique que tant qu’il se tient « tout à fait près de lui-même » (Journal, 29 septembre 1931), et loin du public.
Bibliographie raisonnée
ACQUISTO, Joseph, « La musique du désir et de la pureté. Gide face à Chopin et Baudelaire », in Bulletin des Amis d’André Gide, numéro 157, janvier 2008, p. 19-32.
BOMPAIRE, François, « De la musique à l’ironie, et retour. Interprétation musicale et interprétation textuelle dans l’œuvre d’André Gide », in Greta Komur-Thilloy et Pierre Thilloy (dir.), André Gide ou l’art de la fugue, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 175‑194.
BRUNEL, Pierre, Aimer Chopin, Paris, Presses Universitaires de France, 1999.
BRUNEL, Pierre, « Gide et Chopin », in Basso continuo. Musique et littérature mêlées, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, p. 87‑99.
FRANCESCHETTI, Giancarlo, « André Gide Esegeta di Chopin », in Aevum, volume 37, numéro 1‑2, janvier-avril 1963, p. 170-186.
HOEGES, Dirk, « Pro Chopin, Contra Wagner : André Gide und die Musik », in Hans T. Siepe et Raimund Theis (dir.), André Gide und Deutschland, Düsseldorf, Droste Verlag, 1992, p. 58-65.
JEAN-AUBRY, Georges, André Gide et la musique, Paris, Éditions de la Revue musicale, 1945.
LEFÉBURE, Yvonne, « André Gide interprète de Chopin », in Contrepoint, numéro 6, 1949, p. 34-42.
MASSON, Pierre, « Les Notes sur Chopin, ou le livre impossible d’André Gide », in Bulletin des Amis d’André Gide, numéro 166, avril 2010, p. 113‑132.
MASSON, Pierre, « Gide et la musique. De l’impur au pur », in Greta Komur-Thilloy et Pierre Thilloy (dir.), André Gide ou l’art de la fugue, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 37‑52.
MÉTAYER, Bernard, « Gide et Chopin », in Bulletin des Amis d’André Gide, numéro 85, janvier 1990, p. 65-92.
MEYLAN, Pierre, « André Gide, pianiste », in Les Écrivains et la musique, volume 2, Lausanne, Éditions du Cervin, 1952, p. 62-78.
MOUTOTE, Daniel, « La Musique », in André Gide : esthétique de la création littéraire, Paris, Champion, 1993, p. 35‑41.
SCHNYDER, Peter, « André Gide et l’harmonie. Comment une catégorie musicale devient une catégorie existentielle », in Greta Komur-Thilloy et Pierre Thilloy (dir.), André Gide ou l’art de la fugue, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 53-69.
SISTIG, Joachim, André Gide : die Rolle der Musik in Leben und Werk, Essen, Die Blaue Eule, 1994, en particulier p. 193‑206 et p. 401‑430.
SISTIG, Joachim, « La topographie esthétique de l’univers musical gidien », in Greta Komur-Thilloy et Pierre Thilloy (dir.), André Gide ou l’art de la fugue, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 21-37.
TOUDOIRE-SURLAPIERRE, Frédérique, « “Il y a un Gide intime qu’on ne connaît pas. Coupez.” », in Jean-Michel Wittmann (dir.), Gide ou l’identité en question, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 77-100.
VUKUSIC ZORICA, Maja, « “Bez glazbe, život bi bio pogreška” – Chopin kod Gidea, Sartrea, Nietzschea i Barthesa », in Književna smotra, Časopis za svjetsku književnost, numéro 157‑158, 2010, p. 51‑60.
VUKUSIC ZORICA, Maja, « Le piano touchant/touché : l’instrument du contretemps chez Gide, le cas du Journal et des Notes sur Chopin », in Studia romanica et anglica zagrebiensia, numéro 55, 2010, p. 79-102.
VUKUSIC ZORICA, Maja, « Gide et Chopin – le parfait écrivain devrait être musicien », in Bulletin des Amis d’André Gide, numéro 176, octobre 2012, p. 309-352.
VUKUSIC ZORICA, Maja, « Des Notes sur Chopin à l’opéra. L’angle mort du Journal de Gide », in Greta Komur-Thilloy et Pierre Thilloy (dir.), André Gide ou l’art de la fugue, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 151-171.
WALD LASOWSKI, Aliocha, Le Jeu des ritournelles, Paris, Gallimard, 2017.
WALD LASOWSKI, Roman, « Écriture et piano. Gide, Barthes, Chopin », in Raphaël Célis (dir.), Littérature et musique, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2001, p. 161-171.
ZUROWSKA, Joanna, « Gide et Chopin », in Chopin et les Lettres, Varsovie, Centre de civilisation française, 1991, p. 119-125.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Gide André, « Sur l'acteur de cinéma. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 35, juillet 1977, p. 72-3.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Armstrong Christine et Van Tuyl Jocelyn, « Introduction. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°199/200, automne 2018, p. 9-16.
Durosay Daniel, « Colloque "Les premières Rencontres de Colpach" (30-31 mai 1987) », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 81, janvier 1989.
Gide André, Van Tuyl Jocelyn, Latrouitte-Amstrong Christine, « Pensées sous les palmiers du Nouveau Monde : pleins feux sur André Gide. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°131-132, juillet-octobre 2001.
Latrouitte-Armstrong et Van Tuyl Jocelyn, « Gide à la frontière. Actes du colloque de Denison (Ohio) 14-16 juin 2012. Présentation. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 177/178, janvier-avril 2012, p. 9-16.
Maubon Catherine, « Introduction. », Bulletin des Amis d’André Gide, n°153, janvier 2007, p. 10-16.
Paysac Henri de, « Rilke, Kassner, et Gide (Colloque de Sierre, automne 1987) », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 81, janvier 1989.
Safi Fatima, « Avant-propos. », Bulletin des Amis d’André Gide, n°138, avril 2003, p. 145-148.
Safi Fatima, « Gide et le Maghreb : espace de libération et/ou d'exil. », Bulletin des Amis d’André Gide, n°138, avril 2003, p. 149-160.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Conner Tom, « André Gide et Victor Serge : une apologie d'un "individualisme communiste". », Bulletin des Amis d'André Gide, n°131/132, juillet-octobre 2001, p. 485-494.
Guiheneuf Hervé, « A propos de Gide et d'Yvon », Bulletin des Amis d'André Gide, n°124, octobre 1999, p. 343-351.
Jaillet Daniel, « André Gide et son témoin turripinois (Correspondance avec le Dr André Dénier) », Bulletin des Amis d'André Gide, n°134, avril 2002, p. 207-216.
Marin Mihaela, « Retour de l'U.R.S.S. ou l'impossible témoignage de l'Est ... », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 170, avril 2011, p. 211-228.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Canonge Jean-Marc, « Lettres de Gide à Michel Levesque. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°197/198, printemps 2018, p. 55-74
Claude Jean, « André Gide et Jean-Louis Barrult : correspondance inédite (1935-1950). », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 126-127, avril-juillet 2000, p. 233-288.
Claude Jean, « Portrait de Jean Schlumberger d'après sa correspondance (inédite) avec Jacques Copeau. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 139, juillet 2003, p. 357-372.
Copeau Jacques, « Une lettre de Jacques Copeau sur André Gide », Bulletin des Amis d'André Gide, n°21, janvier 1974, p. 8-10.
Fawcett Peter R., « Notes à propos de la Correspondance Ghéon-Gide », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 40, octobre 1978, p. 54-63.
Fawcett Peter, « Remarques sur la Correspondance Gide-Valéry. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 147, juillet 2005, p. 309-326.
Gide André, « A propos de Charles-Louis Philippe : Une lettre inédite de Gide. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°23, juillet 1974, p. 49-52.
Gide André et Ratheneau Walther, « Lettres. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°181/182, janvier-avril 2014, p. 91-96.
Goulet Alain, « Quand Gide rend hommage à Colette. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 146, avril 2005, p. 185-212.
Goulet Alain, « Lettres de Gide aux Lerolle : Nathalie-Sarraute-Gide, une rencontre manquée. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°193/194, automne 2016, p. 113-125.
Goulet Alain, « Lettres de Gide aux Lerolle : une lettre de Ghéon à Maurice Denis. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°193/194, automne 2016, p. 126-132.
Goulet Alain, « Lettres de Gide aux Lerolle : une lettre de Gide à Nicolas Beauduin. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°193/194, automne 2016, p. 133-138.
Laurent Thierry, « Correspondance André Gide - André Maurois. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°189/190, printemps 2016, p. 29-52.
Masson Pierre, « Les correspondances d'André Gide. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°162, avril 2009, p. 163-174.
Masson Pierre et Wittmann Jean-Michel, « André Gide - Arthur Fontaine : Correspondance (1899-1930). », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 174/175, avril-juillet 2012, p. 139-218.
Martin Claude, « La correspondances de Gide : Correspondances déjà publiées, éditions de correspondances en préparation », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 2, octobre 1968, p. 6-8.
Paysac Henri de, « André Gide- Denis de Rougemont : Correspondance inédite », Bulletin des Amis d'André Gide, n°133, janvier 2002, p. 7-24.
Schnyder Peter et Solvès Juliette, « "Je me réjouis immodérément de vous revoir". Quelques particularités de la Correspondance André Gide - Maria Van Rysselberghe. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°190/191, automne 2016, p. 9-20.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette oeuvre. Elles figurent en couleur.
Gide a maintes fois déclaré combien Corydon lui était cher, allant même jusqu’à affirmer à la fin de sa vie, dans sa préface à la traduction américaine, qu’il était « le plus important de [s]es livres » (RR II, 171).
Plus encore que les deux pamphlets contre le colonialisme et que ceux dénonçant le régime communiste en URSS, Corydon aura joué un rôle fondamental dans la prise de conscience, durant l’entre-deux guerres, de l’existence de l’injustice sociale. Il s’agit sans aucun doute d’une œuvre capitale dans la trajectoire de l’écrivain, pivot central autour duquel s’organise tout le reste de sa production littéraire, livre de combat s’il en est, produit de sa prise de conscience du poids de la différence, témoignage de la lutte que l’écrivain aura mené sa vie durant contre les injustices sociales quelles qu’elles soient, au point d’y consacrer sa carrière et d’y sacrifier parfois sa réputation, son mariage, ses amis, n’hésitant pas à devenir celui « qui irait au-devant de l’attaque ; qui, sans forfanterie, sans bravade, supporterait la réprobation, l’insulte » (RR, 67), en somme « une victime expiatoire prédestinée », pour reprendre le mot du fidèle ami Roger Martin du Gard (RR, 1175).
Le silence éloquent et inexpliqué de Gide lors du procès et de la condamnation d’Oscar Wilde en 1895, au moment où la presse française regorge d’articles pour ou contre cet autre martyr homosexuel que fut l’écrivain irlandais, peut-il expliquer en partie le fait que Gide ait finalement pris le risque, trente ans plus tard, de faire don de sa personne pour l’avancement de la cause homosexuelle ? L’allusion au procès de Wilde dans l’incipit de Corydon le laisse penser, et il n’est pas exclu qu’il ait fallu tout ce temps à Gide pour se remettre du scandale de 1895 et du choc que le sort vécu par Wilde a pu provoquer chez lui, et pour tenter ensuite d’organiser une riposte, même si les velléités d’écrire sur la question homosexuelle semblent apparaître quelques mois plus tôt sous la plume de l’écrivain. Dès 1894, en effet, au sortir d’une lecture des Perversions de l’instinct génital d’Albert Moll, l’auteur de La Tentative amoureuse déclarait à son confident de l’époque Eugène Rouart : « J’écrirais quelque chose de rudement mieux sur ce sujet, il me semble » (Corr. Rouart, I, 182). Le choix du mode conditionnel dans la phrase indique cependant combien le projet est encore hypothéqué à toutes sortes de réserves et d’appréhensions que le procès et la condamnation de Wilde l’année suivante ne vont que renforcer. Si Gide parvient à les dépasser en partie pour se lancer finalement dans la rédaction d’un premier texte en 1909, ses inquiétudes n’ont pas disparu pour autant, ainsi qu’il l’exprime dix ans plus tard dans une lettre à Dorothy Bussy, alors qu’il s’apprête à faire imprimer de manière anonyme un tirage à 21 exemplaires des deux premiers dialogues, réservés à quelques rares intimes et à lui-même, la plus grande partie de ces exemplaires ayant fini dans un tiroir : « La partie que je m’apprête à jouer est si dangereuse que je ne la puis gagner sans doute qu’en me perdant moi-même » (RR, 1172). De façon significative, la genèse et l’histoire éditoriale de Corydon (nous renvoyons sur ce point à la « Notice » préparée par Alain Goulet pour l’édition Pléiade du texte) racontent le long et douloureux cheminement de son auteur jusqu’au moment où il se décidera enfin à donner de son texte sous son nom une édition moins confidentielle au printemps 1924, décision qui n’est sans aucun doute nullement étrangère au fait que Proust ait lui-même fait paraître les deux tomes de son Sodome et Gomorrhe quelques mois plus tôt. On sait combien Gide se sentait révulsé par la figure des « sodomites » et des « invertis » proustiens, à laquelle il opposait celle du « pédéraste », qu’il revendiquait lui-même, convaincu que la vision proustienne de l’homosexualité ne pouvait qu’induire le public en erreur et perpétuer en son sein un jugement défavorable vis-à-vis des homosexuels. Dans Corydon, le lecteur sera d’ailleurs parfois surpris d’entendre le personnage éponyme reprocher à l’homosexualité « ses dégénérés, ses viciés et ses malades » (RR, 74). Curieuse manière de prendre la défense de l’homosexualité ! Mais Gide n’échappe pas toujours aux préjugés de son époque (comment le pourrait-il ?), et, aussi surprenant que cela puisse paraître, on trouve dans son œuvre des traces d’homophobie refoulée.
Corydon est donc à replacer entre les deux figures tutélaires de l’homosexualité dans la littérature européenne du début du XXe siècle : Oscar Wilde et Marcel Proust. Mais Gide ne se place pas uniquement sur le plan de la littérature, même s’il s’inspire, dans son troisième dialogue notamment, des œuvres de Virgile, Longus, Montesquieu, Goethe, Gourmont et Barrès, pour ne citer qu’eux. Son discours s’inspire davantage de celui du naturaliste cherchant à intégrer l’homosexualité dans l’ordre des phénomènes présents dans la nature en tous lieux et à toutes les époques. Plus encore que la représentation littéraire que Proust vient de donner de l’homosexuel dans Sodome et Gomorrhe, c’est celle véhiculée par une littérature scientifique dégageant « une intolérable odeur de clinique » (RR, 73) que l’écrivain rejette (de fait, le personnage éponyme accusé de « penchants dénaturés » a fait de « brillantes » études de médecine, apprend-on dès la première page du texte). Mais Gide n’est pas médecin, et ses tentatives successives pour élaborer des démonstrations parfois fastidieuses ont pu décourager ses lecteurs les plus sensibles (« C’est que je m’adresse et veux m’adresser à la tête et non point au cœur », J1, 685), et encourager au contraire ses détracteurs les plus cyniques.
Toutefois, malgré cette inflexion naturaliste, Corydon est une œuvre littérairement complexe : ce qui retient tout particulièrement l’attention, c’est le fait que le livre soit entièrement constitué d’un dialogue sur un autre livre que le lecteur est censé lire un jour, et dont il ne lira en fait que l’avant-texte. Si l’on songe inévitablement à Paludes et aux Faux-Monnayeurs, ce procédé laisse surtout entendre que le plaidoyer gidien en faveur de la pédérastie est en fait inachevé, Gide en étant resté aux prolégomènes : en d’autres termes, Corydon dénoncerait (et tenterait d’excuser) ses propres faiblesses. Échappant à l’accomplissement et au pouvoir irrévocable et réducteur des mots imprimés sur le papier, ce work-in-progress refuse d’être figé dans le langage, de même que l’identité homosexuelle résiste à toute cristallisation verbale. Et c’est ainsi que, si le propos de Gide dans Corydon a inévitablement vieilli avec le temps, la forme du texte demeure d’une étonnante modernité.
Bibliographie raisonnée
Ahlstedt, Eva, André Gide et le débat sur l’homosexualité, Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis, 1994.
Cairns Lucille, « Corydon : politique de la sexualité, politique des sexes. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°130, avril 2001, p. 219-242.
Courouve, Claude, « Les vicissitudes de Corydon », dans André Gide, Corydon, Paris, Gallimard, « folio », 1991.
Dollimore, Jonathan, Sexual Dissidence : Augustine to Wilde, Freud to Foucault, New York/Oxford, Oxford University Press, 1991.
Goulet, Alain, Notice et notes de Corydon, dans André Gide, Romans et récits, œuvres lyriques et dramatiques, vol. 1, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2009, p. 1162-1200.
Goulet, Alain, Notice de Corydon, dans Pierre Masson et Jean-Michel Wittmann (éds.), Dictionnaire Gide, Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 102-104.
Goulet, Alain, Les Corydon d’André Gide, Paris, Orizons, 2014.
Legrand, Justine, André Gide : de la perversion au genre sexuel, Paris, Orizons, 2012.
Lucey, Michael, Gide’s Bent : Sexuality, Politics, Writing, New York/Oxford, Oxford University Press, 1995.
Nazier, François, L’Anti Corydon (essai sur l’inversion sexuelle), Paris, Éditions du siècle, 1924.
Nemer, Monique, Corydon citoyen : essai sur André Gide et l’homosexualité, Paris, Gallimard, 2006.
Pollard, Patrick, André Gide. Homosexual Moralist, New Haven/London, Yale University Press, 1991.
Porché, François, L’Amour qui n’ose pas dire son nom (Oscar Wilde), Paris, Grasset, 1927.
Roulin Jean-Marie, « La camera oscura d’André Gide, ou l’écriture du plaisir homosexuel », Studi Francesi [Online], 170 (LVII | II) | 2013. (version papier p. 385-395).
Segal, Naomi, André Gide : Pederasty and Pedagogy, London, Clarendon Press, 1998.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Alblas Anton, « Lecteur et lecture (2). », Bulletin des Amis d’André Gide, n°151, juillet 2006, p. 467-488.
Benjamin Martine, « Gide aurait-il été "Charlie" ? », Bulletin des Amis d'André Gide, n°199/200, automne 2018, p. 131-144.
Bertrand Stéphanie, « ."Je ne suis pas pareil aux autres". Le je gidien entre désir de singularité et tentation de banalité. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 177/178, janvier-avril 2012, p. 133-144.
Bertrand Stéphanie, « L'aphorisme dans l'œuvre d'André Gide. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°189/190, printemps 2016, p. 131-140.
Bertrand Stéphanie, « Gide et le démon de l'analogie. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°199/200, automne 2018, p. 161-172.
Bourjade Anne, « Quand deux fondations s'allient. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°190/191, automne 2016, p. 89-94.
Chaoui Mokhtar, « André Gide ou l'art de la fugue. », Bulletin des Amis d’André Gide, n°138, avril 2003, p. 197-208.
Duboile Christophe, « La Correspondance du Mauvais-Riche d'André Ruyters : un manifeste anti-gidien. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°128, octobre 2000, p. 495-510.
Dubois Elsa, « Le je gidien, à la frontière du roman et du mythe. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 177/178, janvier-avril 2012, p. 145-156.
Emeis Harald, « Guy au Saillant. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 137, janvier 2003, p. 53-66.
Escobar Matthoew, « Le problème du contrôle du texte gidien : entre ouverture et fermeture. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°130, avril 2001, p. 203-218.
Fortin Nathalie, « L'éloge du vivant chez André Gide. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 167, juillet 2010, p. 333-354.
Genova Pamela, « André Gide tient-il toujours son rang ? », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 177/178, janvier-avril 2012, p. 113-132.
Goulet Alain, « Gide à l'œuvre. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°134, avril 2002, p. 179-192.
Masson Pierre, « La main passe, le message demeure... », Bulletin des Amis d'André Gide, n°163, juillet 2009, p. 285-286.
Masson Pierre, « Gide et les frontières intérieures. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 177/178, janvier-avril 2012, p. 17-30.
Masson Pierre, « Gide et son image. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°199/200, automne 2018, p. 17-32.
Prince Gerald, « Commentaire », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 68, octobre 1985, p.47-52.
Prince Gerald, « Commentaire », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 76, octobre 1987, p.48-50.
Sagaert Martine, « André Gide hors-cadre. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 177/178, janvier-avril 2012, p. 47-60.
Savage Brosman Catharine, « Gide à la frontière du bonheur. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 177/178, janvier-avril 2012, p. 157-178.
Segal Naomi, « La peau d'André Gide. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 177/178, janvier-avril 2012, p. 31-46.
Vucel Yerminn, « La Syntaxe gidienne. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 145, janvier 2005, p. 79-86.
Vucel Nerminn, « Le Narrateur gidien. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 146, avril 2005, p. 231-244.
Wittmann Jean-Michel, « En être ou ne pas en être. Gide face aux terres en marge de la culture, barbares et méconnues. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 177/178, janvier-avril 2012, p. 179-190.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette œuvre. Elles figurent en couleur.
Ce livre est à la fois marginal et essentiel dans l’ensemble des œuvres de Gide. Il devait être, selon ses termes, son « premier livre » et sa « Somme ». Cette ambition s’explique par l’âge et la situation de son auteur : à vingt ans, Gide était épris d’un amour mystique pour sa cousine Madeleine ; il était aussi, nourri à la fois de la Bible et de l’idéal symboliste, hanté par l’ambition de conquérir l’immortalité de l’artiste qui s’apparentait pour lui à la vie éternelle. Enfin, il lui fallait donner un sens à ce qui constituait pour lui une impasse, à savoir la dichotomie entre son amour et ses désirs, la femme aimée lui apparaissant simultanément comme un recours nécessaire et une tentation honteuse. Il devait donc à la fois poser un but, et le montrer inaccessible ; aussi la solution de la mise en abyme, qu’il théoriserait peu après, s’imposait d’elle-même : non pas dire l’amour, mais montrer un héros s’efforçant de le dire et, tout en le sacrifiant, donner au récit de ses efforts la perfection d’une œuvre accomplie. Il va ainsi imaginer un porte-parole, André Walter, acharné à écrire lui-même l’histoire d’un alter ego, Allain, que son déchirement entre chair et idéal spirituel mène à la folie, Walter mourant à son tour en laissant un roman dont on ne nous livre que les cahiers préparatoires.
Le 8 mai 1890, au moment de se mettre au travail, Gide se trace donc ce programme : « Il faut faire Allain. Examen d’André Walter. […] Dire, pour André Walter, l’absence de conclusion qui déroute. […] Il faut croire que c’est dans l’absolu que l’on travaille. » En juin, il s’installe pour un mois à Menthon-Saint-Bernard. Début juillet, sa première partie presque achevée, il revient à La Roque, où la seconde partie est achevée le 17 septembre. Le travail de reprise se prolonge, au cours duquel, sur les conseils de son cousin Albert Démarets, Gide supprime les deux tiers des citations bibliques. Du livre, imprimé chez Perrin, il reçoit les premiers exemplaires le 27 décembre. Il en offre un à Madeleine le 1er janvier mais, contrairement à son espoir, celle-ci va maintenir son refus de l’épouser. Dans le même temps, Gide prépare une seconde édition, plus luxueuse, pour la Librairie de l’Art indépendant. Selon les affirmations ultérieures de Gide, l’édition Perrin était tellement fautive qu’il décida de la mettre au pilon. Il n’empêche que c’est chez Perrin que Barrès, feuilletant un exemplaire de ce livre, voulut faire la connaissance de Gide, et le présenter deux jours plus tard à Mallarmé au cours du banquet offert à Moréas. La fortune littéraire de Gide commençait. Il avait atteint, au moins partiellement, son but. Mais désormais il allait inverser sa tactique, et faire de chacun de ses livres suivants la critique de toute prétention à faire œuvre définitive. Ce n’est pas par hasard si, dans Les Faux-Monnayeurs, on voit Édouard, romancier raté, se rendre chez Perrin pour « la réédition de [s]on vieux livre »…
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette œuvre. Elles figurent en couleur.
Bibliographie raisonnée
Geerts Walter, Le Silence sonore. La poétique du premier Gide, Namur, P. U. de Namur, 1992.
Marty Éric, « La première fiction de Gide », Poétique, n° 72, 1987, p. 463-482.
Masson Pierre, « Tableaux d'une exaspération. Sur une édition illustrée des Poésies d'André Walter. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°165, janvier 2010, p. 137-142.
Wittmann Jean-Michel, « Une épiphanie de l’artiste : la lutte avec l’ange dans Les Cahiers d’André Walter »,Bulletin des Amis d'André Gide, n° 110-111, juillet 1996, p. 167-176.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette œuvre. Elles figurent en couleur.
Van Rysselberghe Maria, « Fragments inédits des Cahiers de la petite Dame. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 97, janvier 1993, p. 103-117.
Van Rysselberghe Maria, « Fragments inédits des Cahiers de la petite Dame. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°181/182, janvier-avril 2014, p. 7-40.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
À l’origine des Caves du Vatican, un fait-divers qui amuse Gide alors qu’il se trouve en Algérie en 1893 : un retentissant procès contre de prétendus « libérateurs de Sa Sainteté » le Pape « emprisonné dans les cachots du Vatican » par des francs-maçons, des escrocs ayant monté cette fable et abusé de la crédulité de croyants sollicités pour participer financièrement à la croisade pour le délivrer (Cf. « Contexte, sources et référents des Caves », CD-Rom : Édition génétique des Caves du Vatican d'André Gide, conçue, élaborée et présentée par Alain Goulet ; réalisation éditoriale : Pascal Mercier.Sheffield : André Gide Editions Project ; et Paris: Gallimard, 2001). A quoi est venue se greffer l’idée d’un « acte gratuit » commis par un adolescent : Lafcadio. Ce projet prend consistance après 1902, lorsque Gide se met à concevoir un roman d’aventure qui redonnerait vigueur au genre du roman suranné et languissant de l’époque. Après Isabelle (1911), ce projet de roman connaît un début d’exécution, bien laborieux d’abord à cause de la difficulté de trouver le ton juste et de marier les différentes intrigues. Pour se mettre dans le bain, Gide lit et relit De Foe, Stevenson, Fielding ; et bientôt, il s’écrie : « Les Caves deviennent un livre prodigieux ! » Jacques Copeau, qui l’accompagne tout au long de la genèse de l’ouvrage, définit en mai 2012 le roman de l’avenir par son « aptitude à narrer de longue haleine des aventures », son « esthétique de l’illogique et de l’inconditionné », son mode de composition « multiforme, ramifié, souple comme l’ordre musical ». Enfin, en 1913, Jacques Rivière publie un grand article sur « Le roman d’aventure » qui « sera tout entier en acte ». Gide, sur le point de boucler son roman, lui écrit alors : « C’est bien précisément parce que je vois le Roman […] comme vous le voyez vous-même, que même Les Caves je ne puis les considérer comme un roman, et que je tiens à mettre sous le titre : Sotie. »
C’est donc comme « sotie » que paraissent Les Caves du Vatican en 1914, d’abord en feuilleton dans La Nouvelle Revue française (de janvier à avril), puis l’édition originale en deux volumes et la première édition courante suivent fin mai début juin.
La sotie se présente comme une succession d’aventures qui se déroulent au présent au cours de l’année 1893 : au centre, la fable de l’enlèvement du Pape, montée par Protos, entourée des péripéties des trois personnages « crustacés », fantoches encroûtés dans leurs idéologies : le savant scientiste et franc-maçon Anthime Armand-Dubois qui se convertit au catholicisme ; l’écrivain mondain Julius de Baraglioul à la logique simpliste qui conçoit soudain l’acte gratuit au pied du Pape auquel il vient demander réparation pour son beau-frère ; Amédée Fleurissoire le « jobard », animé par sa croyance religieuse naïve, qui s’imagine en preux chevalier partant délivrer le Pape ; ces trois personnages se laissant donc retourner au gré des événements. S’opposent à eux les « subtils » : la contre-société du « Mille-Pattes » (essentiellement Protos), et Lafcadio, jeune homme bâtard évoluant en marge de la société et de ses règles, qui commet un « acte gratuit » en jetant sans raison Fleurissoireau bas d’un train en marche. Après de rocambolesques aventures et les morts de Juste-Agénor, père de Lafcadio, de Fleurissoire, et de Carolaassassinée par Protos, la sotie se termine par un apparent retour à l’ordre : Anthime abjure sa foi catholique en apprenant que le Pape n’est pas le vrai et retourne à sa libre pensée ; Julius retrouve son personnage de romancier moraliste et mondain imbu de sa logique afin d’être élu à l’Académie française ; et Fleurissoire se trouve remplacé auprès de son épouse dès son enterrement par son ami Blafaphas. Mais s’opposent aussitôt à ce retour à l’ordre social l’union incestueuse de Geneviève, la fille de Julius, et de Lafcadio son oncle, puis l’interrogation finale de celui-ci concernant sa voie à suivre, abandonnant résolument Geneviève qui vient de le ramener à la vie et de lui offrir son amour.
L’œuvre fait aussitôt scandale, avec sa mise en procès ironique des institutions sociales et des idéologies : Église catholique, franc-maçonnerie, scientisme, sans compter diverses évocations des tendances homosexuelles de Lafcadio qui déclenchent la fureur de Paul Claudel et entraînent sa rupture avec Gide. De proche en proche, c’est l’existence de Dieu qui est mise en cause, d’un Dieu garant de l’ordre et des valeurs. Les notions de vrai et de faux, d’apparence et de réalité, tendent à se mêler ou à s’invertir. Au-delà du procès du scientisme, c’est tout le problème de la connaissance scientifique, des comportements et des déterminations qui est en question. S’y ajoutent les procès de la famille, « grande chose fermée » ; de la morale, avec le thème de la mort du Père et de la révolte contre la Loi ; la disparition d’un Pape fantoche appelant celle de Dieu ; la conception de Lafcadio, le bâtard ; le mépris que Geneviève manifeste à l’égard de son père…
Protos (= premier, en grec) est comme un délégué de l’auteur, non seulement en inventant et conduisant la fiction de l’enlèvement du Pape qui met en branle l’essentiel de l’intrigue, en intervenant directement ou non auprès des personnages pour infléchir leur conduite, mais aussi en énonçant, auprès de Lafcadio, quelques règles de sociologie appliquée sous forme de préceptes : « n'avoir jamais l'air de ce qu'on [est] » ; « dans la vie, l'on se tire des pas les plus difficiles en sachant se dire à propos : qu'à cela ne tienne » ; « Des gens de la société, comme vous ou moi, se doivent de vivre contrefaits » ; « pour faire de l'honnête homme un gredin ? Il suffit d'un dépaysement, d'un oubli ! » ; la notion de société est fondamentale car on ne peut « sortir d'une société […] sans tomber du même coup dans une autre » ; « une société [ne peut] se passer de lois » (RR1, 1053 et 1158-1161).
L’ironie narrative n’empêche pas l’investissement personnel de Gide. En chacun des trois « crustacés » que sont Anthime, Julius et Amédée, il glisse certains traits de sa personnalité pour s’en purger en s’en moquant : au premier, il confère son goût pour les sciences et les expériences, son émoi devant certains vauriens ; à travers le second, ce sont certains aléas de sa vie d’homme de lettres qu’il présente ; et il attribue au troisième certains de ses avatars de voyageur dont il se gausse, sa manière par exemple de se tromper de train, de tenir ses comptes, d’accueillir les rencontres, son expérience des hôtels et du barbier de Naples. Et certains traits des relations de couple sont nourris du vécu de l’auteur. Avec Lafcadio, c’est au contraire un être selon ses vœux qu’il conçoit, libéré de toutes les contraintes qui ont pesé sur lui, de la famille, l’école, la religion, la morale, et pouvant suivre ses propres désirs. Avec Protos se manifeste son côté démoniaque et fabulateur.
Les Caves du Vatican, étape fondamentale dans la conquête du roman, constituent un pivot fondamental dans la carrière de Gide, ce qu’il souligne à la fin de son épître dédicatoire : « il m'apparaît que je n'écrivis jusqu'aujourd'hui que des livres ironiques — ou critiques, si vous le préférez — dont sans doute voici le dernier. » Suivront en effet des œuvres dans lesquelles il s’affirmera, essentiellement Corydon et Si le grain ne meurt.
Bibliographie raisonnée
Éditions
Les Caves du Vatican, éd. d'Alain Goulet, in Romans et récits. Œuvres lyriques et dramatiques, vol. I, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2009 (texte p.993-1196 , notice, note sur le texte, notes p.1463-1502).
Goulet Alain, édition génétique des Caves du Vatican, librement accessible.
Études critiques
Le Centenaire des « Caves du Vatican », Bulletin des Amis d'André Gide, automne 2014, n° 183-184.
Angelo Anne-Sophie, Le Sens des personnages chez André Gide, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque gidienne », 2016 (et tout particulièrement les pages).
Fillaudeau Bertrand, L’Univers ludique d’André Gide. Les soties, Paris, José Corti, 1985.
Goulet Alain, Les Caves du Vatican d’André Gide. Étude méthodologique, Paris, Larousse, « Thèmes et textes », 1972.
Goulet Alain, Fiction et vie sociale dans l’œuvre d’André Gide, Paris, Minard, « Lettres modernes », 1985 (et tout particulièrement les pages ).
Saggiomo Carmen, La Fortuna italiana delle « Caves du Vatican » di Andre Gide, prefazione di Pierre Masson, Ariccia, Aracne editrice, 2015.
Articles critiques
Anton Sonia, « L'adaptation théâtrale des Caves du Vatican de 1933. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°165, janvier 2010, p. 59-102.
Backès Jean-Louis, “L’acte gratuit, invention des poètes symbolistes ?”, Nouvelle Revue de Psychanalyse, XXXI, printemps 1985, p.93-105.
Bancroft W. Jane, “Les Caves du Vatican : vers l’écriture du roman”, André Gide, no 6 : Perspectives contemporaines, Paris, Lettres modernes / Minard, 1979, p.159-175.
Bompaire François, "Je et Les Autres. Ironie et sociologie dans Les Caves du Vatican d'André Gide", in J.-M. Wittmann (éd.), Gide ou l'identité en question, Paris, Classiques Garnier, "Bibliothèque gidienne", 2017, p.151-165.
Cancalon Elaine D[avis], “La structure du système dans Les Caves du Vatican : approches sémiques, fonctionnelle et formelle", André Gide, no 7: Le romancier, Paris, Lettres modernes / Minard, 1984, p.117-144.
Field Trévor, “Les soubassements littéraires des Caves du Vatican”, BAAG, no 55, juillet 1982, p.369-373.
Goulet Alain, “L’écriture de l’acte gratuit”, André Gide, no 6 : Perspectives contemporaines, Paris, Lettres modernes / Minard, 1979, p.177-201.
Goulet Alain, “Horizons anglais des fictions gidiennes”, in André Gide et l’Angleterre, édité par Patrick Pollard, ‘Le Colloque Gide’, Birbeck College, Londres, 1986, p.112-117. (À propos des citations anglaises dans Les Caves.)
Goulet Alain, « La Longue Marche vers l'édition génétique des Caves du Vatican », Bulletin des Amis d'André Gide, n°128, octobre 2000, p.399-410.
Goulet Alain, « Prolégomènes à une relecture des Caves du Vatican », Bulletin des Amis d'André Gide, n°128, octobre 2000, p.411-426.
Goulet Alain, « Comment concevoir et organiser l'édition génétique d'une œuvre littéraire ? L'exemple des Caves du Vatican », Bulletin des Amis d'André Gide, n°129, janvier 2001.
Goulet Raymond, “L’ironie des Caves du Vatican”, André Gide, no 10 : L’écriture d’André Gide 1 : genèses et spécificités, Paris-Caen, Lettres modernes / Minard, 1998, p.245-255.
Masson Pierre, “Paul Bourget au pays d’André Gide ou le cave du Vatican”, BAAG, no 43, juillet 1979, p.33-41.
Masson Pierre, « Quelques recoins des Caves. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 137, janvier 2003, p. 11-20.
Mercier Pascal, « Recensement », Bulletin des Amis d'André Gide, n°128, octobre 2000, p.471-480.
Oliver Andrew, « Dans les caves des Caves du Vatican », Bulletin des Amis d'André Gide, n°131-132, jullet-octobre 2001.
Rosner Anna, « Les Caves du Vatican, ou la nouvelle Bible. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°145, janvier 2005, p. 47-62.
Steel David A[ngus], “Gide and the conception of the bastard”, French Studies, juillet 1963, p.238-248.
Steel David A[ngus], “Le prodigue chez Gide : essai de critique économique de l’acte gratuit”, Revue d’Histoire Littéraire de la France, XVII, no 2, mars-avril 1970, p.209-229. (Texte remanié et repris sous le titre “Gide’s Prodigal : Economics, Fiction and the Acte Gratuit” dans l’anthologie de textes critiques réunis par David Walker, André Gide, Londres et New York, Longman, 1996, p.52-78.)
Steel David A[ngus], “Lafcadio ludens” : Ideas of play and levity in Les Caves du Vatican”, The Modern Language Review, juillet 1971, vol. 66, no 3, juillet 1971, p.554-564.
Steel David, “Fiction, relativity theory, quantum chaology and Big Bang : the case of Les Caves du Vatican”, French Cultural Studies, vol. IX, février 1998, p.1-17.
Tilby Michael, “Les Caves du Vatican ou le roman impossible”, André Gide, no 11 : L’écriture d’André Gide 2 : méthodes et discours, Paris-Caen, Lettres modernes / Minard, 1999, p.33-54.
Van Tuyl Jocelyn, « Intrigues et complots. Les Caves du Vatican d'André Gide et Anges et démons de Dan Brown. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°162, avril 2009, p. 193-202.
Walker David H[arold], “Gide et le discours criminologique”, André Gide, no 11 : L’écriture d’André Gide 2 : méthodes et discours, Paris-Caen, Lettres modernes / Minard, 1999, p.123-146.
Walker David H[arold], “Gide et le fait divers", Littératures contemporaines no 7 : “André Gide”, études réunies par Pierre Masson, Paris, Klincksieck, 1999, p.37-54.
West Russell, « Jim et Lafcadio », Bulletin des Amis d’André Gide, n° 106, avril 1995, p.293-302.
West Russell, « Moll Flanders et Robinson Crusoé à Paris », Bulletin des Amis d’André Gide, n° 124, octobre 1999, p.353-372.