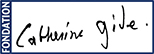Un Centre dédié à la recherche sur André Gide
Le Centre d’Études Gidiennes a vocation à coordonner l'activité scientifique autour de Gide, diffuser les informations relatives aux manifestations gidiennes et à rendre visibles et accessibles les études qui lui sont consacrées.
Nous trouver
Centre d’études gidiennes Bureau 49, bâtiment A UFR Arts, lettres et langues Université de Lorraine Île du Saulcy F-57045 Metz cedex 01Nous écrire
Stephanie Bertrand Jean-Michel Wittmann
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Ifri Pascal, « Gide et Proust face à la Grande Guerre : un parallèle. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°193/194, automne 2016, p. 33-44.
Masson Pierre, « André Gide et l'affaire Swann. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°181/182, janvier-avril 2014, p. 109-122.
Rivalin-Padiou Sidonie, « Marcel Proust et André Gide, autour de Sodome. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 137, janvier 2003, p. 43-52.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette oeuvre. Elles figurent en couleur.
Gide rattache l’origine de ce roman à la mort d’Anna Shackleton, survenue en mai 1884 ; autour de cet événement se greffaient apparemment le remords de ne pas avoir su entourer Anna à ses dernières heures, et l’idée que pour elle cette approche avait été une épreuve. Ce projet, plus tard, se compléta, Gide notant, lui qui venait de découvrir en Algérie une nouvelle manière d’adorer le Créateur : « Possibilité de détresse : l’âme qui croit avoir mal adoré (Mort de Mlle Claire) » (J1, 184).
Après plusieurs faux départs, il entreprend son récit en 1906, l’appelant désormais La Porte étroite, ayant trouvé l’image capitale autour de laquelle va s’organiser le drame. Dans cette version apparaît la mère d’Alissa, figure ambiguë, presque autant victime que bourreau de son mari. Pour dépeindre ses héros, Gide relit ses lettres à Madeleine, et le journal que celle-ci tenait en 1891, dont il reversera des passages dans le journal d’Alissa. Au printemps, il écrit le premier chapitre, consacré pour l’essentiel à la description du jardin de Cuverville, qui deviendra Fongueusemare. À nouveau interrompu, il ne se relance qu’en juin 1907 ; après un essai de récit objectif, il revient à une narration à la première personne qui lui permet d’investir son héros-narrateur de sentiments avec lesquels lui-même veut prendre ses distances.
Le roman s’organise ainsi comme une machine infernale : tout part de Lucile, la mère d’Alissa, présentée comme la coupable idéale. De son infidélité résultent l’horreur de sa fille pour une sensualité dont elle a cependant hérité, et l’exaltation mystique de Jérôme. À partir de là, le roman s’organise en une série de mouvements pendulaires, Jérôme ne cessant de revenir auprès d’Alissa, et de la fuir peu après, chassé autant par lui-même que par elle. Si l’on est amené à comprendre qu’Alissa se connaît mal, et que son drame consiste à découvrir trop tard que sa nature la porte vers un hédonisme dont sa foi l’a frustrée, on doit aussi se méfier de Jérôme, qui ne se plie à la règle dont il attribue la rigueur à Alissa, que parce qu’elle l’arrange obscurément. Et du même coup le lecteur est invité à se défier d’un récit effectué pour l’essentiel par ce personnage ambigu. Toute La Porte étroite est à considérer comme la confrontation de deux consciences en partie volontairement aveugles sur elles-mêmes, et donc forcément sur autrui.
L’investissement autobiographique n’a pas seulement permis à Gide de faire vivre ses personnages, mais aussi de faire mourir en lui certains interdits. C’est cet enjeu qui l’a contraint à enfermer dans la forme la plus impeccable des problèmes pour lui aussi brûlants. Ce livre, autant qu’il lui permettait d’avancer dans la libération de soi, le posait en champion du classicisme qu’on érigeait à cette époque en modèle absolu, et dont La NRF qu’il fondait alors avec ses amis allait se proclamer la servante zélée.
Bibliographie raisonnée
Éditions
La Porte étroite, éd. Pierre Masson, in Romans et récits. Œuvres lyriques et dramatiques, vol. I, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2009 (texte p. 809-912, notice, note sur le texte, notes p. 1425-1477).
Dossier de presse
Lionnet Jean, Pilon Edmond, Canydo Ricciotto.
Études critiques
Lévy Zvi, Les structures dramatiques et les procédures narratives de « La Porte étroite », Nizet, 1984.
Wégimont Marie, Regard et parole dans « La Porte étroite » d’André Gide, Lyon, Centre d’études gidiennes, 1994.
Articles critiques
Cazentre Thomas, « Les comédiens sans le savoir : l'inconscient dramatique dans La Porte étroite », Bulletin des Amis d'André Gide, n°141, janvier 2004, n°145, p. 7-30.
Lionnet Jean, « Lecteur de L'Immoraliste et de La Porte étroite. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°133, janvier 2002, p. 31-32.
L. Kaplan Carol, « Peindre le portrait d'Alissa : Gide en train de "lire" Amour de Maurice Denis. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°166, avril 2010, p. 189-204.
Masson Pierre, « Les brouillons de La Porte étroite. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 148, octobre 2005, p. 471-510.
Sonnenfeld Albert, « Baudelaire et Gide : La Porte étroite », La Table ronde, mai 1967, p. 79-90.
Steel David, « Antécédents gidien. Mathilde Rondeaux : Lucile Bucolin. Mythe d'une naissance, naissance d'un mythe. », Bulletin des Amis d'André Gide, janvier 2005, p. 7-22.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette oeuvre. Elles figurent en couleur.
Prométhée délivré de ses chaînes survient, un jour des années 1890, sur les boulevards parisiens, où vient de se produire une scène énigmatique racontée en focalisation externe par un narrateur anonyme. Un monsieur maigre ramasse le mouchoir tombé de la poche d’un monsieur gras qui, en récompense, lui remet une enveloppe où écrire un nom et une adresse de son choix, puis lui donne une gifle avant de disparaître…
L’œuvre au titre ludique et transgressif, ouverte sur cet étrange récit, se clôt sur un épilogue tout aussi étrange, précédé d’une épigraphe empruntée au Journal des Goncourt : « On n’écrit pas les livres qu’on veut ». La citation en forme d’excuse adressée aux critiques rappelle l’avant-propos de Paludes attendant du lecteur « la révélation de nos œuvres ». Tout livre de Gide est en soi une interrogation sur la littérature, surtout quand il surprend par son saugrenu et rompt, comme Le Prométhée mal enchaîné, avec les conventions les mieux établies. Le texte, d’abord étiqueté roman dans L’Ermitage, devient ensuite sotie par contamination de Paludes, dont il s’approprie deux personnages, et des Caves du Vatican, avec laquelle il partage une réflexion sur l’acte gratuit.
Ce récit s’insère aussi dans le paradigme des œuvres qui, du Traité du Narcisse à Thésée, manipulent ironiquement le mythe. Le Prométhée gidien combine plusieurs figures empruntées à la tradition eschyléenne et aux drames romantiques de Goethe et de Shelley. Il est ainsi le lieu d’une tension entre deux lectures opposées du mythe, celle du héros sacrifié, mis en scène dans Philoctète, et celle du héros révolté et libéré, qui l’emporte cette fois. Dans l’édition originale, la portée éthique du livre est soulignée par l’inscription en annexe de trente-trois « réflexions » reprises des Réflexions sur quelques points de littérature et de morale et ensuite reversées dans le Journal. Mais elle s’exprime aussi sans cet appendice, dans l’image de l‘aigle qui dévore le foie de Prométhée jusqu’à ce que celui-ci le tue et se serve de l’une de ses plumes pour écrire le livre que nous lisons. Cette allégorie de la création littéraire libératrice et du nécessaire recul qui l’accompagne et qui peut prendre les différentes formes du rire, est représentée dans l’œuvre par une composition complexe. La sotie se manifeste par le brouillage des indices spatio-temporels et des repères culturels, coupant tout lien apparent avec l’usage, voire avec la logique, et déroutant les attentes : ainsi le réalisme illusoire de l’incipit ou les allusions bibliques inattendues dans le contexte du mythe grec. La sotie est aussi, par sa liberté, expérimentation de formes : la scène initiale, par exemple, est racontée six fois par des narrateurs différents et la structure apparente du récit à la rigueur rhétorique extrême s’avère un trompe-l’œil. Elle est encore appel à une lecture moins linéaire que transversale, on le voit avec la présence de figures structurelles comme la circularité, la répétition ou la mise en abyme qui procède à une réécriture de l’histoire de Prométhée et de son aigle à travers celle de Tityre et de son chêne. Situé au moment où Gide achève un premier cycle de ses œuvres et s’interroge sur les genres littéraires, Le Prométhée mal enchaîné constitue une étape dans la recherche d’une formule du roman qui, par-delà les soties et les récits, aboutira à l’écriture des Faux-Monnayeurs.
Bibliographie raisonnée
Principales éditions
PO L’Ermitage, janvier 1899, p. 37-54 ; février 1899, p. 125-142 ; mars 1899, p. 196-215.
EO Mercure de France, 1899.
Éditions de la NRF, 1920, illustrée de trente dessins de Pierre Bonnard.
Gallimard, 1925 (édition bleue mise en vente en 1926).
Œuvres complètes, tome III, éd. Louis Martin-Chauffier, Gallimard, 1933, p. 97-160.
Romans, Récits et Soties, Œuvres lyriques, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », éd. Jean-Jacques Thierry, 1958, p. 301-341.
Romans et Récits, Œuvres lyriques et dramatiques, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », vol. I, éd. Pierre Masson, 2009, p. 465-509.
Études critiques
Bulletin des amis d’André Gide, n° 49, janvier 1981, n° spécial consacré au Prométhée mal enchaîné, p. 5-88.
Dossier de presse, Bulletin des amis d’André Gide, n° 49, janvier 1981, p. 60-71 (5 articles) ; n° 57, janvier 1983, p. 71 (1 article).
Brée, Germaine, « Signification du Prométhée mal enchaîné et sa place dans l’œuvre d’André Gide », The French Review, vol. 26, n° 1, octobre 1952, p. 13-20.
Gutwirth, Marcel, « Le Prométhée de Gide », Revue des sciences humaines, n° 116, décembre 1964, p. 507-519.
Holdheim, William, « The Dual Structure of the Prométhée mal enchaîné », Modern Language Notes, vol. 74, n° 8, décembre 1959, p. 714-720.
Masson, Pierre, Dictionnaire Gide, Classiques Garnier, « Dictionnaires et Synthèses », n° 1, 2011, p. 325-327.
Spacagna, Antoine, « Prolégomènes à une lecture “parabolique” du Prométhée mal enchaîné », Bulletin des amis d’André Gide, n° 50, avril 1981, p. 203-216.
Weinberg, Kurt, On Gide’s « Prométhée » : Private Myth and Public Mystification, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1972.
À l’heure où son magister sur les milieux littéraires et artistiques est à son apogée mais suscite paradoxalement de très violentes polémiques, André Gide publie, en 1921, à l'attention du public adolescent et en parallèle d’un ouvrage similaire à destination d’un lectorat plus mûr, une anthologie personnelle de son œuvre sous le titre de Pages choisies chez l’éditeur Georges Crès, au sein de la collection « Le Florilège contemporain ». Ce recueil d’analectes, né d'une sélection personnelle d’André Gide, offre aux jeunes lecteurs de l’époque un lieu propice à la découverte de l’œuvre gidienne autant qu’un espace singulier permettant à l’auteur d’effectuer un premier bilan de son activité intellectuelle et d’envisager la fabrique d’un futur lectorat.
En effet, des plus belles pages de Si le grain ne meurt – inédit alors en volume – aux morceaux les plus signifiants des Nourritures terrestres, en passant par Le Voyage d’Urien, Les Caves du Vatican, La Porte Étroite, des extraits de ses récits de voyage ou de son célèbre Journal, ce florilège autographe propose aux lecteurs adolescents de découvrir, en suivant le chemin tracé par l’auteur à leur attention, ce qu'il convient de nommer une « œuvre-vie ». Douze extraits de l’œuvre d’André Gide, comme autant de chapitres d'un récit de voyage et d'étapes d'une existence, qui offrent un aperçu unique de sa production, un espace où se déploie l'histoire de sa pensée, l'évolution de ses idées, les différents aspects de son activité intellectuelle et artistique.
Né de l'épars, forme même de la fragmentation, objet de l'éclatement passé et de l’unité retrouvée, les Pages choisies réalisent l'harmonie parfaite du tout et de la partie réunis en un ouvrage à valeur d’œuvre propédeutique. André Gide s'y raconte dans un parcours en forme de confessions successives de divers états d'âme, s'y lit comme un intransigeant commentateur de son œuvre dont il tente d'élaborer l'unité́ provisoire, et s'y observe modelant, par le prisme de la fragmentation, la figure idéalisée de ses futurs lecteurs.
Hadrien Courtemanche
Bibliographie :
- D.C., préface aux Pages choisies d'André Gide, Georges Crès, « Bibliothèque de l'adolescence », Paris, 1921.
- Félix Bertaux, « Le démon d'André Gide », Ère nouvelle, le 23 décembre 1921.
- Conférence, donnée par Hadrien Courtemanche, doctorant en Littérature française de l’Université Sorbonne Paris Nord, pour l’ouverture de la 63ème saison de l'Association Guillaume Budé d'Orléans, le 28 septembre 2017 au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, intitulée « Les Pages choisies d'André Gide ou la fabrique du lecteur », disponible en ligne https://textechoix.hypotheses.org/195
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette oeuvre. Elles figurent en couleur.
Paludes, petit livre qui raconte l’histoire d’un écrivain qui ne fait rien d’autre qu’écrire Paludes, témoigne de l’enfermement maniaque, névrotique, dans la création, sur un mode grinçant et ironique qui le fera finalement classer par Gide dans le genre des soties, comme Le Prométhée mal enchaîné et Les Caves du Vatican. Le projet de Paludes remonte vraisemblablement au début du printemps 1893, avant son premier séjour en Afrique du Nord, mais la conception et l’écriture de cette sotie, l’année suivante, sont directement marquées par ce séjour qui transforma sa vision du monde. De retour en France, Gide porte en lui « un secret de ressuscité » et connaît « cette sorte d’angoisse abominable que dut goûter Lazare échappé du tombeau » : « Un tel état d’estrangement […] m’eût fort bien conduit au suicide », raconte Gide rétrospectivement, « n’était l’échappatoire que je trouvai à le décrire ironiquement dans Paludes. » (Si le grain ne meurt)
L’écriture de Paludes a donc pour Gide une fonction de catharsis : elle lui permet de se purger d’un certain nombre d’idées, de sentiments, désormais caducs, voire gênants, car sa vision du monde s’est modifiée à la faveur des expériences algériennes. Gide n’hésite pas à laisser parler son inconscient, comme il le revendique dans sa préface, et une scène onirique et fantasmatique comme la scène de chasse aux canards, voisine avec le récit d’un cauchemar obsédant. À travers la relation platonique qui unit le narrateur et sa compagne Angèle, il tourne en dérision André Walter et, du même coup, son amour platonique pour sa cousine Madeleine. L’ironie permet cependant à Gide d’établir une distance salutaire vis-à-vis de représentations qui, sans cela, prendraient une teinte morbide. En reprenant et en amplifiant certaines caractéristiques formelles du Voyage d’Urien, en donnant notamment libre cours à un « certain sens du saugrenu » (Si le grain ne meurt) déjà apparu dans le Voyage, il affirme avec force sa « plaisanterie particulière » (Littérature et Morale), cette marque du créateur authentique, selon lui.
Au moment de la rédaction, Gide a bien conscience d’écrire « une satire du temps présent » (lettre à A. Mockel). Désireux de prendre ses distances avec l'« atmosphère étouffée des salons et des cénacles, où l’agitation de chacun remuait un parfum de mort » (lettre à P. Claudel), il fait la satire du milieu littéraire parisien et, plus particulièrement, du symbolisme. Pour autant, la démarche de Gide ne laisse pas d’être ambiguë : dirigé contre les cénacles, Paludes est aussi écrit pour eux et multiplie allusions littéraires et private jokes. Tous les personnages sont renvoyés dos-à-dos, du littérateur à Angèle en passant par « le grand ami Hubert ». La satire vise et l’artiste, et les philistins, mais « celui qui écrit Paludes » est une sorte de « saint en art », comme Mallarmé qu’il ne cesse d’invoquer. Satire du symbolisme mais aussi de la vanité propre aux littérateurs, qui est de tous les temps et de tous les pays, Paludes est l’œuvre d’un moraliste et comme telle, a une résonance universelle. L’ironie indécidable qui irrigue constamment l’écriture fonde la modernité de cette œuvre qui appelle de ses vœux la « collaboration » du lecteur (Préface de Gide) et sera saluée par Roland Barthes comme « un grand livre, et un livre moderne », et comme « une des cinq ou six œuvres les plus importantes de notre temps » par Nathalie Sarraute.
Bibliographie raisonnée
Éditions
Paludes, éd. Jean-Michel Wittmann, in Romans et récits. Œuvres lyriques et dramatiques, vol. I, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2009 (texte p. 257-326, notice, note sur le texte, notes p. 1292-1311).
Études critiques
Angelet Christian, Symbolisme et invention formelle dans les premiers écrits d’André Gide (« chapitre troisième : Paludes ou la fiction de la liberté »), Gand, Romanica Gandensia XIX, 1982.
Bertrand Jean-Pierre, Paludes d’André Gide, Paris, Gallimard, coll. Foliothèque, n° 97, 2001.
Wittmann Jean-Michel, Symboliste et déserteur. Les œuvres fin de siècle d’André Gide, Paris, Honoré Champion, coll. Romantisme et modernité n° 13, 1997.
Numéros de revue
Paludes, 1982, Bulletin des Amis d’André Gide, n° 54, avril 1982.
Retour à “Paludes”, Bulletin des Amis d’André Gide, n° 77, janvier 1988.
Articles critiques
« Paludes : pages retrouvées », Bulletin des Amis d'André Gide, n°117, janvier 1998, p. 63-67.
Constant Isabelle, « "Qu'est-ce que tu fais ? - J'écris Paludes". L'aporie gidienne. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 126-127, avril-juillet 1990, p. 289-298.
Constant Isabelle, « Le drame au passé simple : Paludes. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 130, avril 2001, p. 191-202.
Hers Paul d', « Tour des marais », Bulletin des Amis d'André Gide, n°77, janvier 1988, p.5-21.
H. Walker David, « "Paludes au cinéma" : un texte d'André Silvaire », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 145, janvier 2005, p. 87-90.
Masson Pierre, « Paludes ou la chasse aux canards », André Gide 7, Minard 1984.
Michelet Valérie, « Le carnet de notes et l'agenda comme programmation de l'écriture dans deux romans fin-de-siècle : Sixtine, de Remy de Gourmont, et Paludes, d'André Gide. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 126-127, avril-juillet 1990, p. 299-318.
Raimond Michel, « Modernité de Paludes », Australian Journal of French Studies, janvier-août 1970, p. 189-194.
Sagaert Martine, « Modernité de Paludes », in Kopp Robert et Schnyder Peter (éds.), André Gide et la tentation de la modernité, actes du colloque international de Mulhouse de 2001, Paris, Gallimard, coll. Les Cahiers de la NRF, 2002, p. 297-314.
Savage-Brosman Catharine, « Le monde fermé de Paludes », André Gide 6, Paris, Minard, 1979, p. 143-157.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Bourdil André, « André Gide et son peintre. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 176, octobre 2012, p. 291-308.
L. Kaplan Carol, « Peindre le portrait d'Alissa : Gide en train de "lire" Amour de Maurice Denis. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°166, avril 2010, p. 189-204.
L. Kaplan Carol, « Le dialogue Gide/ Matisse dans Genevièvre. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°185/186, janvier-avril 2015, p. 39-48.
Martin Claude, « Pour un centenaire. André Gide et le peintre polonais Witold Wojkiewicz (1879-1909). », Bulletin des Amis d'André Gide, n°43, juillet 1979, p. 89-94.
Martin Claude, « Un autre peintre ami d'André Gide : Jan Vanden Eeckhoudt (1875-1946) », Bulletin des Amis d'André Gide, n°43, juillet 1979, p. 95-100.
Martin Claude, « Gide et Mac Avoy », Bulletin des Amis d'André Gide, n°51, juillet 1981, p. 275-278.
Marchand Jean-José, « Pierre Sichel », Bulletin des Amis d'André Gide, n°64, octobre 1984, p. 541-552.
Prévost Jean-Pierre, « Histoire d'un tableau. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°187/188, juillet-octobre 2015, p. 11-20.
Schnyder Peter, « L'art de bien faire : Gide entre Verhaeren et Van Rysselberghe. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°187-188, juillet-octobre 2015, p. 39-60.
Sichel Pierre, « Gide et son portrait », Bulletin des Amis d'André Gide, n°64, octobre 1984, p. 553-560.
Tamburini Nicole, « Une Lecture, portrait de groupe ou peinture d'histoire ? », Bulletin des Amis d'André Gide, n°187-188, juillet-octobre 2015, p. 21-38.
Walter François, « Sur trois tableaux », Bulletin des Amis d'André Gide, n°70, avril 1986, p. 41-49.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette oeuvre. Elles figurent en couleur.
Perséphone, sur une musique d’Igor Stravinsky, fut représenté pour la première fois le 30 avril 1934 à l’Opéra de Paris avec Ida Rubinstein pour la danse, Jacques Copeau pour la mise en scène, Kurt Jooss pour la chorégraphie, et André Barsacq pour les décors. La collaboration ne fut pas sans accroc : Stravinski, qui voulait se débarrasser du narcisse et de la grenade (dignes, disait-il, de l’époque d’Oscar Wilde), n’appréciait pas la prosodie de Gide, tandis que l’auteur du livret n’aimait pas la musique. En plus – et à la grande réprobation de Gide – Copeau et ses collaborateurs semblaient célébrer la messe.
Le mélodrame représente le renouveau d’un projet, Proserpine, qui date des premières années de la vie littéraire de Gide. Perséphone est maintenant divisé en trois tableaux, suivant le système antique qui classait les saisons. Le premier nous montre la prairie où la jeune fille cueille le narcisse dans le calice duquel elle voit aux Enfers « Tout un pauvre peuple dolent ». Au deuxième tableau, Perséphone est reine des Enfers : elle goûte les grains de la grenade, ce qui assure sa présence auprès de Pluton. Dans une vision, elle voit la terre hivernale et les soins que donne Déméter, sa mère, au nourrisson Démophoon. Au troisième tableau, Perséphone renaît à la vie : grâce aux labours de Démophon devenu Triptolème, la terre nourricière accueille le printemps, mais Perséphone ne peut échapper au destin et, à la fin du mélodrame, elle regagne le pays souterrain pour apporter aux ombres « Un peu de la clarté du jour, / Un répit à leurs maux sans nombre, / À leur détresse un peu d’amour ». L’ensemble est conçu comme la célébration d’un rite religieux à la manière de l’ancien culte élusinien. C’est pour cette raison que le prêtre d’Éleusis, Eumolpe, prend la parole au début de chaque tableau pour en expliquer la signification : l’invocation à Déméter, « dispensatrice du blé », et l’indication du rapt de sa fille Perséphone ; la présentation des Enfers, et « l’infernal Pluton [qui] / Ravit […] / à la terre son printemps » ; le retour de Perséphone et du printemps grâce à l’effort de Démophoon. Les figurants dans la première version avaient été nombreux – Proserpine, Cérès [Déméter], Pluton, Calypso, Eurydice, avec, mimants ou dansants, Mercure, Hercule, Atalante, Tantale, et d’autres … Dans la nouvelle version, nous voyons Eumolpe, Perséphone, et les deux chœurs – celui des nymphes, celui des enfants – et, dans le deuxième tableau, le chœur des Ombres. On fait tout simplement allusion aux autres personnages mythologiques. Gide avait écrit à Stravinski qu’il envisageait le mélodrame « à mi-distance entre l’interprétation naturelle » du rythme des saisons, « et l’interprétation mystique ». À la première époque, il avait mis à contribution l’Hymne homérique à Déméter et le chant XI de l’Odyssée (Ulysse qui interroge les Ombres), le tout dans la traduction de Leconte de Lisle. En 1932 venait s’y ajouter une lecture des Greek Studies de Walter Pater, qui lui offrait une nouvelle traduction en raccourci de l’Hymne et un commentaire sur les mystères d’Éleusis dont il profitait pour développer l’aspect mystique de son œuvre.
La version primitive de Proserpine semble avoir été conçue au début des années 1890, époque de la composition du Traité du Narcisse et des lectures du Monde comme volonté et représentation de Schopenhauer. Elle est annoncée comme Le Traité des trois grains de la grenade en 1893. Dans la symbolique gidienne, ce fruit est l’emblème de la vie, de la jouissance et du désir. Proserpine est annoncé comme « drame » en 1896, et Gide continue à y réfléchir. En 1909, Florent Schmitt lui demande s’il n’a pas un texte qui donnerait un prétexte pour monter une féerie ou un ballet. Gide lui suggère ce scénario « de derrière les fagots » qu’il appelle une symphonie dramatique en quatre tableaux, mais le projet n’aura pas de suite. Des fragments en sont publiés dans Vers et Prose en 1912, date à laquelle le compositeur Paul Dukas s’y intéresse aussi. En 1913 Gide, marqué peut-être par son enthousiasme pour Nijinski et les Ballets russes de Diaghilev, se met en contact avec le groupe des émigrés russes où se retrouvent Igor Stravinski, le peintre décorateur José Maria Sert, et Ida Rubinstein, qui commanditera la mise en musique éventuelle.
Dans la première version, Gide semble avoir pris comme point de départ le mythe d’Orphée et d’Euridyce, et avoir voulu mettre l’accent non sur la faiblesse et le triste sort du poète, mais sur l’insatisfaction de l’héroïne. En effet, l’attente d’Eurydice ne sera jamais comblée, et les Ombres d’Orion, de Tantale, d’Hercule, d’Hippomène et des Danaïdes représenteront le même symbole du désir inassouvi – la condition nécessaire de la vie selon l’éthique symboliste. En effet la phrase « le geste inachevé » deviendra en 1934 « le geste insensé de la vie ». On a interprété Perséphone de plusieurs façons. Outre l’histoire symbolique des saisons, on y a trouvé une allégorie du communisme (notons que Gide reprend en tête du Retour de l’U.R.S.S. en 1935 l’histoire de Déméter qui nourrit une humanité future), un rappel de la charité chrétienne, et même l’emblème du travail de l’artiste. Mais Jean Claude a sans doute raison lorsqu’il déclare que le mélodrame « est loin d’être une œuvre engagée ». Perséphone nous aide à mesurer le chemin qui sépare Gide schopenhaurien et symboliste de l’écrivain qui, après la Grande Guerre, prend en pitié la souffrance humaine.
Bibliographie raisonnée
Éditions
Proserpine. Perséphone, édition de Patrick Pollard, Lyon, Centre d’Études gidiennes, 1977.
Perséphone [et Proserpine], édition de Jean Claude, in Romans et récits. Œuvres lyriques et dramatiques, vol. 2, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2009 (texte p. 715-731, notice p. 1306‑1318).
Études critiques
Claude Jean, « André Gide et le théâtre », Paris, Gallimard, 1992.
Claude Jean, « Autour de Perséphone », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 73, janvier 1987, p.23-55.
Claude Jean, « Perséphone ou l’auteur trahi ? », dans Pascal Lecroart (éd.), Ida Rubinstein. Une utopie de la synthèse des arts à l’épreuve de la scène, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2008, p. 213-233.
Claude Jean, « Perséphone », dans Dictionnaire Gide, (éd. Pierre Masson et Jean-Michel Wittmann), Paris, Classiques Garnier 2011, p. 303-304.
Claude Jean, « Proserpine 1909 », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 54, avril 1982, p. 251-268. [*Avec les lettres échangées par Gide et Florent Schmitt.]
Claude Jean, « Perséphone à Milan », Bulletin des Amis d'André Gide, n°81, janvier 1989.
Claude Jean, « Proserpine », dans Dictionnaire Gide, (éd. Pierre Masson et Jean-Michel Wittmann), Paris, Classiques Garnier 2011, p. 327.
Levitz Tamara, « Modernist Mysteries: Perséphone. ». Oxford and New York: Oxford University Press, 2012.
Métayer Bernard, « Perséphone », Bulletin des Amis d'André Gide, n°70, avril 1986, p. 85-86.
Pollard Patrick, « André Gide : a musical chronicle», dans Adam (préface de Miron Grindea), n° 468-480, ["1986" = 1988].
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette oeuvre. Elles figurent en couleur.
Philoctète, abandonné sur une île déserte à cause d’une blessure nauséabonde, a emporté dans cet exil forcé l’arc et les flèches d’Hercule. C’est pour cette raison qu’Ulysse et Néoptolème le cherchent, car selon une prophétie les Grecs pourraient encore gagner la guerre contre les Troyens grâce à ces armes, qui devront alors servir à la cause commune, que le possesseur le veuille ou non. Voilà en bref l’intrigue de Sophocle, mais que Gide réélabore de manière personnelle. En fait, bien que des lectures sophocléennes soient attestées déjà en 1892, Philoctète est la première approche théâtrale de Gide. Dans cette relecture du mythe, Ulysse dévoile in medias res son projet : afin d’accomplir la volonté divine, sa ruse devra guider l’innocence de Néoptolème dans le vol des armes de Philoctète. Comme l’escroquerie d’Ulysse, porte-parole de la morale collective, s’oppose à la sincère honnêteté de son jeune disciple, le fils de Laërte, selon une modalité expressive constamment antiphrastique, fait appel au devoir envers la Grèce pour l’emporter sur les scrupules de Néoptolème: comme les amants s’immolent pour leur maîtresse, affirme-t-il, comme Agamemnon a sacrifié Iphigénie, ainsi Philoctète cédera finalement ses armes.
Commencée en 1894, annoncée en 1896 dans le Centaure, après la parution de deux fragments dans la Revue sentimentale en 1897, la pièce fut entièrement publiée en 1898 dans la Revue Blanche et en 1899 au Mercure de France. Paradoxalement, le drame, paru avec quelques-uns des traités, sans aucune « prétention scénique », sera mis en scène plusieurs fois, en France ainsi qu’à l’étranger. Que l’on y reconnaisse les réflexions d’un « être de dialogue » vouées à la lecture ou qu’il s’agisse, par contre, du point de convergence des œuvres gidiennes symbolistes, Philoctète présente un échafaudage scénique intéressant : un décor d’une éblouissante froideur, une atmosphère stylisée d’une glaciale luminosité, n’étant pas sans rappeler l’aboutissement du Voyage d’Urien, et cinq actes de longueur inégale dont quelques scènes sont silencieuses ou consistent en une seule réplique.
Ulysse déclare au fils d’Achille qu’ils guetteront Philoctète « sans être vus », le préparant ainsi à cette rencontre par un escamotage. L’élève est soumis à l’influence du maître, mais depuis la fin des Nourritures une présence redoutable, l’Autre, va bouleverser cet équilibre, selon un schéma récurrent dans les autres pièces contemporaines, Saül, Le Roi Candaule et même Bethsabé. Face à la présence obsédante d’autrui, seul l’isolement incite encore à la vertu car, comme le dit Philoctète, « l’homme qui vit parmi les autres est incapable […] d’une action pure et vraiment désintéressée ». Gide théâtralise son dilemme entre l’individualisme et ce rapport à l’autre, aliénation d’une partie de soi-même. Et la réponse au « Philoctète, enseigne-moi la vertu » de Néoptolème, où résonnent les échos de Nathanaël, sera l’exaltation du dévouement à soi-même, puisque Philoctète dans l’exil de sa diversité s’est fait « de jour en jour moins Grec, de jour en jour plus homme ».
À la même époque Gide rédige Saül et le Roi Candaule. Toujours intéressante, la lecture de Germaine Brée propose de voir Philoctète ou le traité des trois morales comme le panneau central d’un tryptique, entre les deux autres pièces. Trois caractères qui, par excès de disponibilité, accomplissent en connaissance de cause un acte provoquant la perte de l’attribut de leur supériorité et puissance virile (l’arc, la couronne et l’épouse) et d’eux-mêmes. Malgré tout, toutefois, le dépossédé accueille voluptueusement celui qui le dépossède. À ces projections personnelles se superposent d’autres implications, non moins profondes : le premier sous-titre, Traité de l’immonde blessure, a fait penser aux problèmes judiciaires d’Oscar Wilde, que Gide a fréquenté. Et même les connotations dreyfusardes que l’on y a relevées seraient justifiées, la pièce étant, entre autres, destinée à la Revue Blanche engagée dans l’affaire Dreyfus : de telles interprétations mettent en relief la nature intime et composite d’une des premières relectures gidiennes du mythe au théâtre.
Contre Ulysse le mensonger, Néoptolème déclarera enfin son amour envers Philoctète. Et celui-ci, pour sa part, quoiqu’en paria, incarnera la stoïque liberté individuelle dont l’exercice triomphe de la cynique tromperie d’Ulysse : c’est par un acte conscient que Philoctète boira finalement le narcotique qu’il aurait dû avaler à son insu en se faisant sciemment priver des armes. L’acte suprême est accompli. Ulysse ne pourra que l’admirer dans toute sa supériorité. Une porte s’entrebâille sur les actions futures de Saül et de Candaule, mais en même temps sur une jouissance et une ivresse que la vénération de Néoptolème n’a laissé qu’entrevoir.
Bibliographie raisonnée
Édition
Théâtre complet, Neuchâtel-Paris, Ides et Calendes, tome I, 1947 (texte p. 141-180, notice par Richard Heyd p. 183-185).
Études critiques
Brée Germaine, André Gide. L’insaisissable Protée, Paris, Les Belles Lettres, 1953.
Claude Jean, André Gide et le théâtre, Paris, Gallimard, «Les Cahiers de la N. R. F.», 2 volumes, 1992.
Genova Pamela Antonia, André Gide dans le labyrinthe de la mythotextualité, Purdue University Press, 1995.
Longo Marco, Le triangle en travesti: le pièces giovanili di André Gide. Analisi e prospettive, prefazione di Maria Teresa Puleio, Firenze, Olschki, 2006.
Martin Claude, La Maturité d’André Gide. De Paludes à L’Immoraliste (1895-1902), Paris, Éditions Klincksieck, 1977.
Watson-Williams Helen, Gide and the Greek myth, Oxford, Clarendon Press, 1967.
Articles critiques
Claude Jean, « Philoctète à Milan », B. A. A. G., n. 81, janvier 1989, p. 101-104.
Csürös Klára, « Gide et L’Antiquité grecque », Neohelicon, III, tomes 1-2, 1975, p. 343-363.
Germain Gabriel, « Gide et les mythes grecs », Entretiens sur Gide, Paris, La Haye, 1967, p. 41-62.
Larnaudie Suzanne, « Philoctète. Tragédie de Sophocle et drame gidien », Littératures, XVI, juin 1969, p. 107-123.
Louria Yvette, « Le contenu latent du Philoctète gidien », The French Review, n. 5, avril 1952, p. 348-354.
Watson-Williams Helen, «Gide and Hellenism», Modern Language Review, Cambridge, volume 58, 1963, p. 177-183.
Pirandello cite Gide une seule fois, dans une lettre du 2 août 1930 adressée à sa muse Marta Abba qui lui avait demandé un jugement sur l’Annonce faite à Marie de Claudel. Le dramaturge italien répond qu’il n’aime pas la pièce et que, même si Claudel « [a]vec Gide, c’est le plus grand nom de la littérature française contemporaine : toutefois, il existe une différence à [s]on avis : André Gide est encore vivant dans le monde de l’art, tandis que [Claudel], il est déjà mort et enterré depuis quelque temps ». Gide, pour sa part, avait affirmé dans une enquête sur la littérature italienne, probablement au début de sa carrière : « Pirandello, ne connais rien de lui », préférant citer les classiques, Dante surtout, le bien-aimé Leopardi, Carducci, qu’il estimait beaucoup, et D’Annunzio quoiqu’il n’appréciât ni son style, ni son tempérament. Par la suite, Gide n’a toutefois pas ignoré Pirandello et en dépit de cet étrange silence, certains indices prouvent qu’il y a bien eu une relation, ou au moins un commerce littéraire, entre Gide et Pirandello.
Une relation de visu ? Peut-être. Un commerce livresque et littéraire, sans aucun doute. Certes, dès 1931, Pirandello reçoit de la part de l’auteur français une copie d’Œdipe qui se trouve dans sa bibliothèque répertoriée, où figurent aussi quelques-uns des livres de Gide (La Symphonie pastorale ; Morceaux choisis ; Les Caves du Vatican). De plus, la copie d’Œdipe porte la dédicace : « À Luigi Pirandello en cordial et bien attentif hommage, André Gide ». Or, la pièce gidienne renvoie à un premier lien entre les deux : les Pitoëff, amis des deux auteurs, engagés dans les représentations d’Œdipe et interprètes des plus grands succès parisiens de Pirandello.
Quant à la bibliothèque de Gide, elle arbore deux volumes (remontant à 1925 et à 1928) de Masques nus de Pirandello, traduits pour les éditions de la NRF par Benjamin Crémieux et Marie Anne Comnène. Et c’est justement le nom de(s) Crémieux qui devrait être le point de contact nodal entre les deux auteurs. Collaborateur de la NRF, italianisant, principal médiateur de Pirandello en France, lié aux deux écrivains, c’est celui qui insiste le plus sur une comparaison entre l’écriture de Gide et celle de Pirandello (dans Le Capitole en 1928 et dans Candide en 1934), une intuition étayée par une longue liste d’auteurs-passeurs que les deux lisent et méditent à la même époque : Dante, Cervantès, Shakespeare, Montaigne, Pascal, Goethe, Dostoïevski, Carlyle, Unamuno et beaucoup d’autres.
C’est aussi le foisonnant contexte artistique et culturel du Paris des années vingt et trente, entre intellectuels, femmes salonnières, comédiens, comédiennes, dramaturges et metteurs en scène, amis et ennemis, impossibles à énumérer ici, qui recèle un réseau bien serré de liens franco-italiens convergeant vers les deux auteurs, dont une bonne partie participent à la promotion de Pirandello à Paris. L’auteur sicilien, quant à lui, fréquente la capitale française de plus en plus assidûment depuis 1923 et jusqu’à la fin de sa vie (1936), y vivant pendant de longues périodes, surtout entre 1931 et 1935. En particulier, le témoignage de Paola Masino, grande amie et disciple du Maître, est intéressant. Dans une lettre de 1929 depuis Paris à ses parents elle écrit : « Ce soir, je vais chez les Crémieux, où il y a un dîner en hommage à Pirandello, il y aura Gide, Valery [sic], et tous les grands noms de la littérature française ». Benjamin Crémieux, secrétaire à l’époque du PEN Club français, confirme son rôle de lien entre les deux écrivains.
Enfin, après la mort de Gide, dans un hommage italien au Prix Nobel français paru dans La Fiera letteraria, en mars 1951, Pasquale Marino Piazzolla rapporte le contenu de quelques entretiens avec Gide qui ont eu lieu à la fin des années trente, au domicile de ce dernier, rue Vaneau. En fait, s’exprimant au sujet de la littérature italienne, Gide aurait affirmé :
"En ce qui concerne Pirandello, par contre, j’accepte sa sincérité et son engagement pathétique quand il s’exprime à travers la foule de ses personnages, auxquels le destin semble avoir atrophié toute possibilité de vie. Je connais de lui mieux le théâtre que les nouvelles. Même dans la conversation Pirandello se montre pensif et préoccupé. Il continue peut-être de rêver avec ses créatures parce que, tout en conversant, il abandonne dans son discours des jugements déconcertants. C’est un auteur décidément très humain et ce que j’aime chez lui, c’est cette amertume qui ne le distancie jamais des situations les plus paradoxales et parfois si réussies sur la scène."
La connaissance de Pirandello par Gide est donc avérée. Qu’elle ait été directe ou, en grande partie, indirecte, certaines œuvres gidiennes, telles que L’Art bitraire, Le Grincheux, Ainsi soit-il ou Les jeux sont faits, mais aussi Le Retour, Les Caves, Les Faux-Monnayeurs, le triptyque de L’École des femmes, laissent entrevoir, surtout en ce qui concerne le concept et l’emploi de l’humorisme, le thème du masque dans toutes ses réalisations, certains personnages féminins et la conception de la vie comme un théâtre de marionnettes que le personnage de La Pérouse, éminemment « pirandellien », semble bien incarner.
Marco Longo
BIBLIOGRAPHIE RAISONNÉE
Études critiques
Barbina Alfredo, La Biblioteca di Luigi Pirandello, Roma, Bulzoni, 1980.
Cioce Antonella, Realtà romanzesca e dissimulazione ironica. Luigi Pirandello e André Gide, Ariccia-RM, Aracne editore, 2006.
Frabetti Anna, Le Magicien italien. Luigi Pirandello et le théâtre français dans les années vingt et trente, Lausanne, L’Âge d’Homme, 2010.
Pirandello Luigi, Lettere a Marta Abba, a cura di Benito Ortolani, Milano, Mondadori, 1995.
Pollard Patrick, Répertoire des lectures d’André Gide III : DIVERS, Londres, Birkbeck College avec la collaboration de gidiana.net, 2006.
La Biblioteca di Luigi Pirandello. Dediche d’autore, a cura di Saponaro Dina e Torsello Lucia, presentazione di Angelini Franca, Roma, Bulzoni, 2015.
Articles critiques
Piazzolla Pasquale Marino, « Amore di Gide alle lettere italiane », La Fiera letteraria, anno VI, n. 9, 5 marzo 1951.
Sica Beatrice, « Parigi 1929-1931 e oltre », dans Paola Masino, a cura di Beatrice Manetti, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2016.
Sitographie
https://www.fondation-catherine-gide.org/bibliotheque-gide-rouen/catalogue
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
« Deux vers de Gide ... ? », Bulletin des Amis d'André Gide, n°43, juillet 1979, p. 69, octobre 1979, p.87-9.
Gide André, « Poèmes perdus dans des revues. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°197/198, printemps 2018, p. 29-46.
Heinemann Henri, « André Gide et la poésie », Bulletin des Amis d'André Gide, n°130, avril 2001, p. 269-275.
Mégnin Michel, « André Gide, Rudolf Lehnert et la poésie arabe : Images et réalité de la pédérastie en terre d'Islam. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 146, avril 2005, p. 153-179.
Michel Eugène, « Gide et les Elégies romaines de Goethe », Bulletin des Amis d'André Gide, n°130, avril 2001, p. 275-279.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Fongaro Antoine, « André Gide, polémiste par amitié. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°125, janvier 2000.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Bock Hans Manfred, « Pierre Viénot, un médiateur entre la France et l'Allemagne dans le cercle d'amis d'André Gide. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°114/115, avril-juillet 1997, p. 247-67.
Durosay Daniel, « Diplomatie gidienne : Au service du Luxembourg en 1919- et des Mayrisch. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°66, avril 1985, p. 235-52.
Durosay Daniel, « Paris-Berlin via Luxembourg. Un relais dans les relations franco-allemandes de la NRF : la maison des Mayrisch. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°69, janvier 1986, p. 33-56.
Durosay Daniel, « Thésée roi. Essai sur le discours politique dans le Thésée de Gide. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°106, avril 1995, p. 201-21.
Irhing Peter, « André Gide, son image de l'Allemagne et le nationalisme français entre 1900 et 1918. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°114/115, avril-juillet 1997, p. 269-282.
Travers de Faultrier Sandra, « Le peuple juge du peuple. », Bulletin des Amis d'André Gide, n°143-144, juillet-octobre 2004, p. 336-343.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Martin Claude, « Pour un centenaire. André Gide et le peintre polonais Witold Wojtkiewicz (1879-1909). », Bulletin des Amis d'André Gide, n°43, juillet 1979, p. 89-94.
Milecki Aleksander, « André Gide en Pologne, I ; II : L'oeuvre gidienne vue par les critiques polonais (1900-1985). », Bulletin des Amis d'André Gide, n°81, janvier 1989, p. 41-63.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette oeuvre. Elles figurent en couleur.
Voinescu Alice, « Souvenirs de l'Abbaye de Pontigny », Bulletin des Amis d'André Gide, n°121, janvier 1999, p.93-100.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette oeuvre. Elles figurent en couleur.
C’est en 1903, au Mercure de France, que Gide publie Prétextes, où il réunit quelques-uns des textes qu’il a publiés depuis 1898. Le volume porte bien son nom : car la critique, si Gide la pratique comme un art (on connaît le paradoxe wildien cher à Gide : « L’imagination imite, l’esprit critique crée ! »), est avant tout pour l’écrivain un prétexte pour définir les contours de sa propre esthétique, et même parfois de sa propre personnalité. Le sous-titre, d’ailleurs, est révélateur, surtout sous la plume de l’auteur de L’Immoraliste : Réflexions sur quelques points de littérature et de morale.
Jetons un œil sur le sommaire. Gide reprend pour commencer deux conférences : « De l’influence en littérature », prononcée à Bruxelles le 29 mars 1900, et « Les Limites de l’art », « préparée pour l’exposition des Artistes indépendants » de 1901, mais que Gide ne prononça pas. Dans la première, c’est une politique de la littérature qu’il propose : il s’interroge en creux, et sans aucune prétention à l’autorité, sur son propre statut de (potentiel) grand écrivain. Dans la seconde, ce sont les fondements mêmes de son esthétique que Gide expose : l’art naît de ses limites, et vit de les repousser…
Suivent trois textes relatifs, de près ou de loin, à Barrès : « À propos des Déracinés » (L’Ermitage, février 1898), « La Querelle du peuplier » (L’Ermitage, novembre 1903) et « La Normandie et le Bas-Languedoc » (L’Occident, novembre 1902). Gide s’y peint en déraciné, et c’est de l’écrivain presque plus que de la littérature qu’il est question.
Viennent ensuite les « Lettres à Angèle » (L’Ermitage, 1898‑1900), dont Gide modifie la structure au moment de les reprendre dans Prétextes. Les titres des lettres (« I. Mirbeau, Curel, Hauptmann » ; « II. Signoret, Jammes » ; « III. Les naturistes » ; « IV. Barrès, Maeterlinck » ; « V. Verhaeren, Pierre Louÿs » ; « VI. Stevenson et du nationalisme en littérature » ; « VII. De quelques récentes idolâtries » ; « VIII. Sada Yacco » ; « IX. De quelques jeunes gens du Midi » ; « X. Les Mille Nuits et Une Nuit du Dr Mardrus » ; « XI. Max Stirner et l’individualisme » ; « XII. Nietzsche ») font presque attendre une galerie de portraits, un peu à la façon du Livre des masques de Gourmont… Mais Gide n’est pas Gourmont, et il s’attache avant tout à démasquer les écrivains qu’il lit – ceux qu’il admire et qu’il envie, comme Signoret et Jammes, aussi bien que ceux qu’il méprise, comme Stirner.
La section suivante, intitulée « Quelques livres », réunit des comptes rendus parus en 1900 dans La Revue blanche. Gide y parle des Histoire souveraines de Villiers de l’Isle-Adam, du Livre du petit gendelettre de Maurice Léon, de L’Ennemie des rêves de Camille Mauclair, de La Double Maîtresse d’Henri de Régnier, du Livre des Mille Nuits et Une Nuit et de La Route noire de Saint-Georges de Bouhélier (1900). Curieusement, c’est une « Lettre à M. Saint-Georges de Bouhélier » qui clôt la section. C’est un Gide capable de férocité comme d’admiration qui s’exprime dans ces textes. Mais c’est surtout un Gide profondément ambigu que l’on découvre : à l’évidence, il est en proie à la tentation de la théorie, mais il se refuse à pratiquer une parole sentencieuse. Dès qu’il se risque à donner un aphorisme, il recourt à l’épanorthose pour affaiblir sa propre autorité de théoricien : « L’art suprême supplante l’inexistante réalité », écrit-il à propos de Villiers de l’Isle-Adam ; mais immédiatement il ajoute que cet art suprême n’est « qu’une admirable et éblouissante imposture ».
L’avant-dernière section est présentée comme un « supplément » : y sont repris quatre textes (tous parus dans L’Ermitage de décembre 1901) sur Almaïde d’Étremont de Francis Jammes, La Tragédie du nouveau Christ de Saint-Georges de Bouhélier, Figures et caractères et Les Amants singuliers d’Henri de Régnier, et Les Vingt et Un Jours d’un neurasthénique d’Octave Mirbeau.
Enfin, pour clore le recueil, Gide rassemble, sous le titre « In memoriam », trois tombeaux critiques : celui de Mallarmé (L’Ermitage, octobre 1898), celui d’Emmanuel Signoret (L’Ermitage, mars 1901) et celui d’Oscar Wilde (L’Ermitage, juin 1902). Son hommage à l’insolent dandy est particulièrement intéressant, et ce pas uniquement parce qu’il était courageux à l’époque de prendre la défense du martyr homosexuel que fut Wilde : ce qui retient l’attention, c’est que Gide s’abrite derrière la figure de Wilde pour se comporter en théoricien de l’art. Rapportant certains de ses dialogues avec l’écrivain irlandais, il prête, selon un procédé qui lui est cher, certaines de ses idées à son interlocuteur, ce qui lui permet de risquer des hypothèses qu’il n’oserait s’attribuer à lui-même. Ne citons qu’un exemple, particulièrement significatif : « L’œuvre d’art est toujours unique. La nature […] se répète toujours ».
On signalera pour terminer qu’à l’exception du petit essai sur « La Normandie et le Bas-Languedoc », repris dans le volume des Souvenirs et voyages, tous les textes recueillis dans Prétextes sont disponibles dans l’édition Pléiade (1999) des Essais critiques.
Bibliographie raisonnée
« Le Dossier de presse de Prétextes : Jean de Gourmont », dans Bulletin des Amis d’André Gide, no 117, janvier 1998, p. 142‑144.
Béguin, Albert, « Gide critique et créateur », dans Les Critiques de notre temps et Gide, Paris, Garnier Frères, 1971, p. 163-166.
Bertrand, Stéphanie, Gide et l’aphorisme. Du style des idées, Paris, Classiques Garnier, 2018.
Braak, Sybrandi, « André Gide, critique littéraire », dans André Gide et l’âme moderne, Paris, Kruyt, 1923, p. 165 et suivantes.
Davies, John C., « Gide as Literary Critic », dans Modern Languages, mars 1959, p. 12-17.
Fraisse, Emmanuel, « Gide et la lecture : comment se constituer en conscience critique », dans Francis Marcoin et Fabrice Thumerel (éds.), Manières de critiquer, Arras, Artois Presses Université, 2001, p. 71‑82.
Ireland, George William, « Gide et Valéry, précurseurs de la nouvelle critique », dans Les Chemins actuels de la critique, Paris, Union Générale d’Éditions, 1968, p. 34‑57.
Krebber, Günter, Untersuchungen zur Ästhetik und Kritik André Gides, Genève, Droz, 1959.
Martin, Claude, « André Gide critique de Georges Simenon », dans Bulletin des Amis d’André Gide, no 34, avril 1977, p. 39‑44.
Masson, Pierre, « Introduction », dans André Gide, Essais critiques, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, p. IX-LXXVI.
Ninomiya, Masayuki, « Du “Subjectif” aux Prétextes. La formation de Gide critique », dans Gide et la fonction de la littérature, Paris, Minard, 1972, p. 9-26.
Prévost, Jean, « André Gide critique », dans André Gide, Paris, Éditions du Capitole, 1928, p. 235‑246.
Rupolo, Wanda, « Gide, critico del romanzo », dans Nuova Antologia, 117e année, vol. 549, fasc. 2142, avril‑juin 1982, p. 288-302.
Schnyder, Peter, « Gide critique du roman des années 1900 », dans Bulletin des Amis d’André Gide, no 70, avril 1986, p. 65-81.
Schnyder, Peter, « Gide critique et ses premiers critiques », dans Bulletin des Amis d’André Gide, no 77, janvier 1988, p. 83-95.
Schnyder, Peter, Pré-textes : André Gide et la tentation de la critique, Paris, L’Harmattan, 2001.
Schnyder, Peter, « “Vous pouvez tout raconter [...] ; mais à condition de ne jamais dire : Je”. Gide critique de Proust », dans Hélène Baty-Delalande (éd.), André Gide, Les Faux-monnayeurs. Relectures, Paris, Publie-net, 2013, p. 174-195.
Stackelberg, Jürgen von, Drei Dichter als Kritiker : André Gide, Marcel Proust, Paul Valéry, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1965.
Sullivan, Margaret Mae, « André Gide, critique littéraire », thèse de doctorat, Université de Paris, 1954.
Thibaudet, Albert, « De la critique gidienne », dans Réflexions sur la critique, Paris, Gallimard, 1939, p. 231‑237.
Voigt, Fritz-Georg, « André Gide als literarischer Kritiker », thèse de doctorat, Université d’Iéna, 1921.
Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne. Elles figurent en couleur.
Goulet Alain, « Sur les traces du Réveil. », Bulletin des Amis d'André Gide, n° 170, avril 2011, p. 235-246.