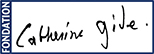Sur ce personnage des Faux-monnayeurs, Gide a donné des clés de lecture. À la correspondante qui croit déceler derrière ce personnage un emprunt aux Mémoires de Saint-Simon, il répond en Appendice du Journal des Faux-Monnayeurs que la première source est son professeur de piano, Marc de Lanux, dont il parle dans Si le grain ne meurt. Le second modèle est « un autre plus bizarre dont je me propose de parler un jour » (JFM, p. 563). Il s’agirait du père Alfred Espinas, beau-père de sa cousine Jeanne, sur qui Gide reviendra dans Ainsi soit-il en insistant sur la « folie » du mari qui, lors de la mort de sa femme, « pensa confusément que ce quelqu’un ne pouvait être que lui » (Ainsi soit-il..., p. 1010), sauf que, durant les prières autour du cercueil, il s’écria : « Mort ou vivant, il faut pourtant que je mange » (Ibid.)
En dépit de la place marginale que Gide donne au personnage de La Pérouse, d’abord dans le Journal et dans Si le grain ne meurt et, finalement, dans Les Faux-Monnayeurs, les sept moments de rencontre d’Édouard avec La Pérouse qui « farcissent » les diverses intrigues du roman pourraient bien révéler un discours « autre » par rapport aux différents récits. Quelques détails suffiront à mieux comprendre. Voilà la première visite d’Édouard à son ancien maître de piano :
La Pérouse est venu m’ouvrir. Il était en bras de chemise et portait sur la tête une sorte de bonnet blanc jaunâtre, où j’ai fini par reconnaître un vieux bas (de madame de la Pérouse sans doute) dont le pied noué ballottait comme le gland d’une toque contre sa joue. Il tenait à la main un tisonnier recourbé. Évidemment je le surprenais dans une occupation de fumiste […] (FM, p. 259-260).
Dans ce passage, quelque chose retient l’attention sans que l’on puisse immédiatement mettre au point une image précise. Enfin, une comparaison avec Pirandello peut aider à interpréter la scène. Le bonnet et le tisonnier renvoient à l’acteur de la sotie, le sot, qui disait ses vérités inconfortables, le bonnet d’âne sur la tête et la marotte à la main. De plus, l’activité de fumiste corrobore cette lecture, dès lors que le terme est pris dans son glissement sémantique vers la fumisterie, c’est-à-dire le manque de sérieux de celui qui démystifie avec fantaisie. À cette acception du terme s’ajoute la nuance de la couleur jaune qui, dans la symbolique médiévale, était associée au mensonge, à la trahison, aux juifs et aux criminels et qui, en général, avec le vert, caractérisait les vêtements des fous. Bref, on retrouve là les couleurs de la singularité individuelle et sociale. Malgré toutes ces notations, le sens autre que ce passage suggère reste encore incomplet. En effet, si on le relit, on s’aperçoit d’un autre syntagme à double sens : le bonnet était probablement un bas de madame La Pérouse, ce qui veut dire que c’est sa femme qui lui avait « mis » ce bonnet qui le rendait ridicule. Ce détail laisse entendre ainsi que sa femme l’a rendu fou, ou bien le fait passer pour un fou, ou encore le considère comme un fou en raison de sa vision propre de la vérité. Si l’on se rapporte au mariage en crise du couple La Pérouse, ce bonnet acquiert un sens tout à fait pirandellien (ce qui pousse à croire aussi que le choix du mot « gland », tout à fait gidien, en revanche, n’est pas exactement un hasard). Pirandello écrit en 1917 une comédie, Le Bonnet de fou, représentée à Rome en 1923. Il la rédige et la fait mettre en scène dans l’intervalle de temps entre les premières manifestations de la maladie mentale de sa femme, - atteinte de paranoïa se manifestant par des excès de jalousie -, et le moment où il dut enfin décider de la faire enfermer dans une maison de fous. Or, si les sots médiévaux coiffés de leur bonnet d’âne faisaient résonner dans les rues du bourg les grelots de leur marotte, dans le titre en italien de la pièce (aussi bien que dans la version en sicilien), le bonnet est à grelots : c’est le bonnet des bouffons, en particulier des bouffons qui se font croire fous et qui ressemblent de près aux sots. La comédie se fonde sur le bouleversement paradoxal des apparences sociales : tant qu’un adultère n’est pas reconnu comme un fait public, le mari peut même faire semblant de ne pas savoir et accepter la situation. Cependant, lorsque le scandale éclate et que l’honneur du mari en est lésé devant les autres, il faut faire appel aux règles qui régissent la vie en commun. Chacun de nous est une marionnette, mais dans l’interaction avec autrui, chacun doit savoir utiliser les modalités de la coexistence, les trois cordes, selon Pirandello : la sérieuse, sur la tempe droite, la civile, au milieu du front, et la folle, sur la tempe gauche. Dans la vie de tous les jours, les marionnettes vivent sur le mode de la civilité, des façades, mais si celles-ci s’effritent et que la vérité apparaît derrière les convenances, il faut tourner la corde sérieuse, celle qui permet de parler clairement, sans masques, et de trouver un accord valable pour tous, sinon l’on risque de laisser libre essor à la corde folle et de faire n’importe quel geste, même criminel, pour rétablir son honneur.
Or, madame La Pérouse est accusée d’être jalouse et le premier épisode se referme sur l’image, à en croire le mari, de la femme qui « traverse une crise terrible » (FM, p. 263), car « [e]lle devient folle » (Ibid.). Le suivant s’ouvre en revanche sur madame La Pérouse qui accueille Édouard à la porte. Cette fois-ci, c’est l’état de santé mentale inquiétant de monsieur La Pérouse qui est au premier plan, car il se refuse à se soigner et fait n’importe quoi pour agacer sa femme et lui déplaire. Les deux versions se confrontent comme dans un jeu de miroirs, sans que l’on puisse déterminer où est la vérité et qui est le véritable fou, s’il y a un fou. Gide pose la question en termes de martyr et de bourreau, ce qui rappelle les atmosphères pirandelliennes de Comme ci (ou comme ça), mais surtout de Chacun sa vérité, où la vérité, impossible à atteindre, se présente à la fin comme le personnage voilé de la femme de Monsieur Ponza et de la fille de madame Frola à la fois, s’exclamant : « Moi, c’est celle qu’on me croit » [Così è (se vi pare), p. 528]. Les différentes versions possibles des faits se côtoient en effet le long du récit gidien, dans la scène où madame La Pérouse accuse son mari de vouloir l’enfermer dans une maison de retraite. Et Gide ajoute : « Ceci était dit sur un ton apitoyé qui respirait l’hypocrisie », et ensuite : « [t]andis qu’elle poursuivait ses doléances, la porte du salon s’est doucement ouverte derrière elle et La Pérouse, sans qu’elle l’entendît, a fait son entrée. Aux dernières phrases de son épouse, il m’a regardé en souriant ironiquement et a porté une main à son front, signifiant qu’elle était folle » (FM, p. 293). La Pérouse, toujours de manière spéculaire, balaie toutes les accusations que son épouse lui avait adressées, de sorte que la situation se renverse et que l’état mental de sa femme apparaît alors profondément altéré. Car c’est elle qui menace de se faire enfermer dans une maison de retraite pour en finir avec les comportements capricieux et désobligeants de son mari. La vérité demeure donc subjective, parce qu’elle procède de différents points de vue. Cette considération, ainsi que le geste de signifier qu’elle est folle, rappelle la mimique de Ciampa, le héros du Bonnet de fou, expliquant l’emploi des trois cordes aussi bien que l’intrigue d’Un vero uomo, pièce tiré d’une nouvelle de Umanumo que Pirandello met en scène en 1927 et qui ressemble de près à son Bonnet de fou. L’auteur espagnol était connu des deux écrivains et, qui plus est, avait vécu à Paris, rue La Pérouse, quelques années avant Pirandello.
Chaque fois que l’un des époux prend le devant de la scène en devenant le pivot du récit et le porteur d’une des possibles vérités, Gide n’hésite pas à le plonger dans une atmosphère théâtrale. Cela concerne les accoutrements, le bonnet et le tisonnier de Monsieur La Pérouse, la « perruque à bandeaux noirs » qui donne à madame La Pérouse « un aspect de harpie » (FM, p. 293) aussi bien que les lieux de cette « triste comédie » (FM, p. 356) et les attitudes d’acteur du vieillard jusqu’au monologue suivant :
Comme si Dieu ne voulait pas me laisser partir. Imaginez une marionnette qui voudrait quitter la scène avant la fin de la pièce... Halte là ! On a encore besoin de vous pour le finale. […] J’ai compris que ce que nous appelons notre volonté, ce sont les fils qui font marcher la marionnette, et que Dieu tire. Vous ne saisissez pas ? Je vais vous expliquer. Tenez : je me dis à présent : ‘Je vais lever mon bras droit’ ; et je le lève. (Effectivement il le leva.) Mais c’est que la ficelle était déjà tirée pour me faire penser et dire : « Je veux lever mon bras droit »… Et la preuve que je ne suis pas libre, c’est que si j’avais dû lever l’autre bras, je vous aurais dit : « Je m’en vais lever mon bras gauche »… Non ; je vois que vous ne me comprenez pas. Vous n’êtes pas libre de me comprendre… Oh ! je me rends bien compte à présent, que Dieu s’amuse. Ce qu’il nous fait faire, il s’amuse à nous laisser croire que nous voulions le faire. C’est son vilain jeu… Vous croyez que je deviens fou ? À propos : figurez-vous que madame de La Pérouse… vous savez qu’elle est entrée dans une maison de retraite… Eh bien ! figurez-vous qu’elle se persuade que c’est un asile d’aliénés, et que je l’y ai fait interner pour me débarrasser d’elle, avec l’intention de la faire passer pour folle (FM, p. 359).
La Pérouse ressemble alors à un philosophe conscient de l’illusion du choix et du jeu de fantoches - la « fantocciata » de Pirandello - qu’est la vie, bref à un raisonneur désillusionné, à l’instar de Baldovino dans La Volupté de l’honneur, du père dans Les Six Personnages en quête d’auteur, de Ciampa dans Le Bonnet de fou, et de tant d’autres. Defouqueblize avait déjà préfiguré cette posture. Certes, les marionnettes qui se substituent à l’humanité privée de toute volonté d’action, ainsi que la vérité insondable dans le rapport entre monsieur et madame La Pérouse, sont des idées gidiennes, mais elles ne s’inscrivent pas moins dans le sillon de la philosophie pirandellienne. Tout cela fait penser immédiatement à cet humorisme que Pirandello utilise comme instrument pour détecter les dysharmonies de l’existence en les analysant d’un regard lucide mais impitoyable, d’autant plus que souvent, les personnages pirandelliens qui sont capables de se voir vivre se réduisent à une pure logique en agissant comme des « mannequins ».
Il faut encore s’arrêter sur la donnée personnelle : la maladie mentale d’Antonietta Portulano, la femme de Pirandello, a joué un rôle essentiel dans l’œuvre du Sicilien. En fait, Antonietta croyait que son mari la trahissait, malgré les démentis de Pirandello lui-même. C’était l’époque de la rédaction de Feu Mathias Pascal. Mais le rapport bourreau-victime est bien mis en place dans On tourne, où le personnage de Monsieur Cavalena est totalement soumis à la jalousie incontrôlable et inexplicable de sa femme. Il en est tellement conditionné que toute son existence personnelle et professionnelle est bouleversée. En effet, de temps à autre, il écrit des scénarios pour le cinéma qui se terminent toujours avec quelqu’un qui se tue, d’où le sobriquet de « suicide » dont on l’a affublé. De plus, une maladie lui a causé une calvitie que Fabrizio Cavalena cache avec une perruque bouclée et un mauvais chapeau. Un autre personnage-emblème de ce « sentiment du contraire » qui déclenche l’humorisme pirandellien : conscient d’être la proie d’une pauvre malade qu’il aime, il se retrouve figé dans une forme qu’il n’a pas voulue, mais qu’il doit accepter et qui se transforme en cet enfer domestique où personne n’est épargné, même pas leur fille Luisetta que la mère accuse de vouloir lui voler l’argent de sa dot grâce à laquelle ils réussissent à vivre. Dans la vie privée, Antonietta, élevée par un père jaloux jusqu’à l’excès qui la fit éduquer dans un couvent, eut des soupçons à l’encontre de Lietta, sa propre fille, même en l’accusant d’inceste. Lietta fut éloignée de la maison de ses parents mais, frappée d’une pareille accusation, elle tenta de se suicider par un coup de pistolet. Pirandello, lui aussi, envisagea de mettre fin à ses jours et à une situation tellement déchirante, sans compter qu’il n’arrivait plus à vivre de ses gains : « L’argent ne suffit jamais : tout ce qu’on gagne est immédiatement avalé, dévoré par le désordre qui règne chez moi comme un souverain absolu coiffant le bonnet de fous », écrit-il à son ami Ojetti. Gide aurait pu avoir accès à Feu Mathias Pascal et On tourne, traduits en français, le premier en 1910, et le deuxième, en 1925. D’ailleurs, a fortiori, les réflexions de Pirandello dans la lettre à Ojetti ainsi que les blessures infligées par cette femme malade, quoique réélaborées, semblent trouver un écho, de manière surprenante, dans l’histoire que La Pérouse raconte à Edouard à propos de la présumée maladie de sa femme. Mais l’écho est bien audible aussi dans le sentiment d’incertitude qui reste au lecteur sur la version définitive, et donc plus proche de la vérité, et sur l’internement final de madame La Pérouse dans une maison de retraite ou un asile d’aliénés, selon les deux points de vue, de même que sur le propos, irréalisé, de La Pérouse de se suicider. Certes, nous ne pouvons pas ignorer les réprimandes de Gide à l’« impétueuse correspondante » et ses critiques contre la « manie moderne de voir influence (ou “pastiche”) à chaque ressemblance que l’on découvre » (JFM, p. 562). Mais la correspondante accuse Gide de malhonnêteté par rapport à un présumé emprunt littéraire conscient qu’il n’aurait pas avoué. Ce à quoi Gide rétorque qu’une œuvre d’art n’a pas moins de mérite pour s’être inspirée de la réalité. Et si le second cas laissé ouvert, comme toute prétérition, donnait droit à un troisième cas réel, celui de Pirandello et de sa femme ? Il s’agit là d’une hypothèse, bien sûr, même si les ressemblances sont nombreuses. Mais là, en retombant dans le domaine de la littérature, nous commettons peut-être précisément cette même faute que Gide reproche à sa correspondante. Serions-nous obligés de parler de simples coïncidences ? Soit, mais alors l’une d’entre elles revient avec insistance : le Lapérouse des ébauches et manuscrits devient La Pérouse du Journal et des Faux-Monnayeurs ; il s’agit là d’un simple changement graphique, mais les deux lettres majuscules, L et P, se trouvent être – coïncidence ? - les initiales de Luigi Pirandello.
Marco LONGO
BIBLIOGRAPHIE RAISONNÉE
Bussino Giovanni, « Pirandello’s Personal Experience with Madness », Canadian Journal of Italian Studies, 6, 1983, p. 22-38.
Gide André, Ainsi soit-il ou Les jeux sont faits, dans Souvenirs et voyages, édition présentée, établie et annotée par Pierre Masson, avec la collaboration de Daniel Durosay et Martine Sagaert, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2001.
Gide André, Les Faux-Monnayeurs, dans Romans et récits. Œuvres lyriques et dramatiques, t. 2, édition publiée sous la direction de Pierre Masson, avec lacollaboration de Jean Claude, Céline Dhérin, Alain Goulet et David H. Walker, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2009.
Gide André, Journal des Faux-Monnayeurs, dans Romans et récits. Œuvres lyriques et dramatiques, t. 2, édition publiée sous la direction de Pierre Masson, avec la collaboration de Jean Claude, Céline Dhérin, Alain Goulet et David H. Walker, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2009.
Gioanola Elio, Pirandello, la follia, nuova edizione integrata con saggi su Liolà e I sei personaggi, Milano, Jaca Book, 1997.
Giudice Gaspare, Pirandello, Torino, UTET, 1963.
Goulet Alain, André Gide. « Les Faux-Monnayeurs », mode d’emploi, Paris, SEDES, 1991.
Goulet Alain, « En marge des Faux-Monnayeurs. Notes et réflexions. Fragments retranchés et ébauches », dans Romans et récits. Œuvres lyriques et dramatiques, t. 2, édition publiée sous la direction de Pierre Masson, avec lacollaboration de Jean Claude, Céline Dhérin, Alain Goulet et David H. Walker, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2009, p. 500 et p. 1232, note n° 1 au chapitre XIII des Faux-Monnayeurs.
Pirandello Luigi, « Così è (se vi pare) », dans Maschere nude, a cura di Italo Borzi e Maria Argenziano, edizione integrale in un solo volume, Roma, Grandi Tascabili Economici, Newton & Compton, 1993.
Pirandello Luigi, « Il berretto a sonagli », dans Maschere nude, a cura di Italo Borzi e Maria Argenziano, edizione integrale in un solo volume, Roma, Grandi Tascabili Economici, Newton & Compton, 1993.
Pirandello Luigi à Ojetti Ugo, Carteggi inediti, dans Pirandello Luigi, Carteggi inediti (con Ojetti, Albertini, Orvieto, Novaro, de Gubernatis, De Filippo), Sarah Zappulla Muscarà (éd.), Roma, Bulzoni editore, 1980, p. 78.
Pastoureau Michel, « Formes et couleurs du désordre : le jaune avec le vert », in Schmitt Jean-Claude (éd.), Médiévales, « Ordre et désordre », n° 4, 1983, p. 62-73, consulté en ligne le 05/11/2020 et disponible sur www.persee.fr/doc/medi_0751-2708_1983_num_2_4_921
Dictionnaire du Moyen Âge, littérature et philosophie, France, Enciclopædia Universalis, 2019.