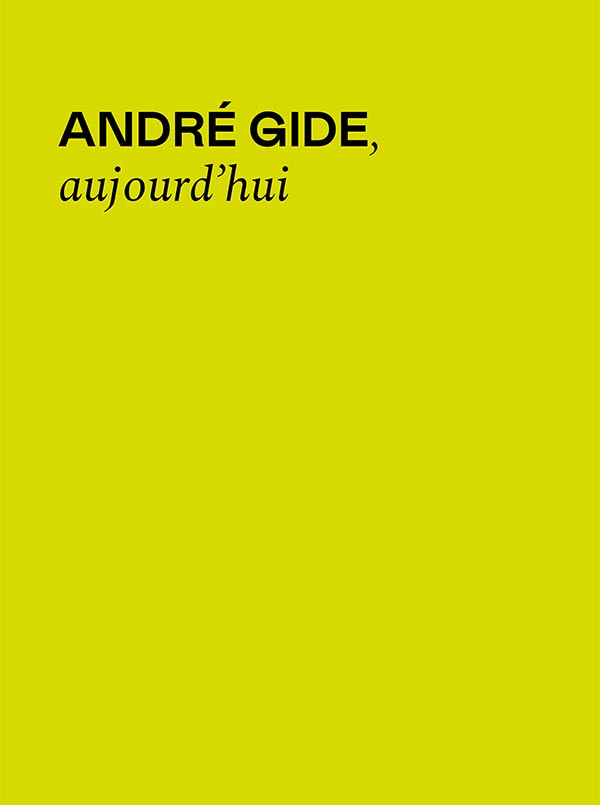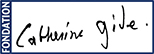Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette oeuvre. Elles figurent en couleur.
Dans une enquête de la revue Les Marges sur l’homosexualité en littérature, le critique Jean de Gourmont écrivait en avril 1926 à propos du Corydon de Gide : « C’est contre ce sentiment d’humiliation et de dégoût de soi-même que Corydon, se sentant fort de l’assentiment de ses disciples, a réagi intellectuellement, en transposant cette humiliation en orgueil. » (Cahiers GKC no 19, 167) Ce qui pouvait peut-être encore se comprendre comme un défi en 1926, deux années à peine après la publication de la première édition de Corydon mise dans le commerce, apparaît davantage aujourd’hui, près d’un siècle plus tard, à l’heure des queer studies, comme une banalité si l’on considère le changement d’attitude de la société vis-à-vis de l’homosexualité. Gide, qui a maintes fois déclaré combien Corydon lui était cher, allant même jusqu’à affirmer à la fin de sa vie, dans sa préface à la traduction américaine, qu’il était « le plus important de [s]es livres » (RR II, 171), n’aura malheureusement pas vu l’aboutissement de son combat puisqu’il meurt moins d’une décennie après l’introduction dans le code pénal, par le régime de Vichy, de l’ordonnance rétablissant la sanction pénale de l’acte homosexuel avec un mineur de 18 à 21 ans, législation discriminante qui restera en vigueur jusqu’en 1982, soit trente ans après la mort de Gide, date à laquelle la France retirera enfin l’homosexualité de la liste des maladies mentales.
À tel point qu’il est possible de discerner dans le processus décrit par Jean de Gourmont (la transposition de l’humiliation vécue par les homosexuels en orgueil) l’embryon de ce qui finira par prendre la forme de la gay pride (« l’orgueil homosexuel ») à partir des années 1970 dans les grandes villes de la plupart des pays occidentaux. La remarque de Gourmont anticipe donc avec cinquante années d’avance, à son corps défendant bien sûr, une des stratégies auxquelles les homosexuels ont eu recours afin de conquérir leur place dans la société, phénomène que le critique anglais Jonathan Dollimore a décrit dans son ouvrage Sexual Dissidence sous le nom de « transgressive reinscription ». Cela consiste, pour un groupe discriminé, à renverser la norme établie pour la réinvestir d’un message positif transgressant cette même norme et permettant à la honte de l’homosexuel, par exemple, de se métamorphoser en orgueil, procédé que le narrateur de Corydon, précurseur de la critique du genre – qui l’eût cru ? – décrivait lui-même : « – Vous cultivez votre bizarrerie [« queerness » en anglais], et, pour n’en être plus honteux, vous vous félicitez de ne vous sentir pas pareil aux autres » (RR, 68). Ainsi, si l’on en croit le critique des Marges, le Corydon de Gide aurait apporté une pierre à l’édifice qui mettra près d’un siècle à se construire dans l’adversité et les drames (songeons au sort des homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale, à ceux des pays communistes, puis à l’épidémie du sida, etc.).
Plus encore que les deux pamphlets contre le colonialisme et que ceux dénonçant le régime communiste en URSS, Corydon aura joué un rôle fondamental dans la prise de conscience, durant l’entre-deux guerres, de l’existence de l’injustice sociale. Il pose aussi les prémisses d’une identité homosexuelle, même si le livre est loin d’attirer de nos jours, hormis les travaux du regretté Alain Goulet, toute l’attention qu’il mériterait de recevoir en dépit de ses faiblesses. De tous les ouvrages de Gide réédités de nos jours, Corydon est sans doute celui qui recueille le moins la faveur des lecteurs et des professionnels de la littérature. Les représentants de l’Éducation Nationale lui préfèrent régulièrement Les Faux-Monnayeurs pour les épreuves du baccalauréat ou de l’agrégation, les chercheurs spécialistes des queer studies se tournent plus volontiers vers L’Immoraliste ou les premiers récits de l’écrivain, tandis que les textes autobiographiques, le journal et la correspondance, à la suite des travaux de Philippe Lejeune et d’Éric Marty, sont en passe d’éclipser le reste de la production gidienne dans le champ de la critique littéraire contemporaine. Depuis ses débuts, et jusqu’à nos jours, Corydon semble ainsi frappé du sceau de l’infamie : trop scandaleux pour la société des années de l’entre-deux guerres, résolument dépassé pour ceux du début du XIXe siècle, le livre n’a jamais trouvé son lectorat. Gide l’avait-il pressenti, lui qui parlait de Corydon comme d’un « terrible livre » (Corr. Ghéon, II, 754) ? Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit sans aucun doute d’une œuvre capitale dans la trajectoire de l’écrivain, pivot central autour duquel s’organise tout le reste de sa production littéraire, livre de combat s’il en est, produit de sa prise de conscience du poids de la différence, témoignage de la lutte que l’écrivain aura mené sa vie durant contre les injustices sociales quelles qu’elles soient, au point d’y consacrer sa carrière et d’y sacrifier parfois sa réputation, son mariage, ses amis, n’hésitant pas à devenir celui « qui irait au-devant de l’attaque ; qui, sans forfanterie, sans bravade, supporterait la réprobation, l’insulte » (RR, 67), en somme « une victime expiatoire prédestinée », pour reprendre le mot du fidèle ami Roger Martin du Gard (RR, 1175).
Le silence éloquent et inexpliqué de Gide lors du procès et de la condamnation d’Oscar Wilde en 1895, au moment où la presse française regorge d’articles pour ou contre cet autre martyr homosexuel que fut l’écrivain irlandais, peut-il expliquer en partie le fait que Gide ait finalement pris le risque, trente ans plus tard, de faire don de sa personne pour l’avancement de la cause homosexuelle ? L’allusion au procès de Wilde dans l’incipit de Corydon le laisse penser, et il n’est pas exclu qu’il ait fallu tout ce temps à Gide pour se remettre du scandale de 1895 et du choc que le sort vécu par Wilde a pu provoquer chez lui, et pour tenter ensuite d’organiser une riposte, même si les velléités d’écrire sur la question homosexuelle semblent apparaître quelques mois plus tôt sous la plume de l’écrivain. Dès 1894, en effet, au sortir d’une lecture des Perversions de l’instinct génital d’Albert Moll, l’auteur de La Tentative amoureuse déclarait à son confident de l’époque Eugène Rouart : « J’écrirais quelque chose de rudement mieux sur ce sujet, il me semble » (Corr. Rouart, I, 182). Le choix du mode conditionnel dans la phrase indique cependant combien le projet est encore hypothéqué à toutes sortes de réserves et d’appréhensions que le procès et la condamnation de Wilde l’année suivante ne vont que renforcer. Si Gide parvient à les dépasser en partie pour se lancer finalement dans la rédaction d’un premier texte en 1909, ses inquiétudes n’ont pas disparu pour autant, ainsi qu’il l’exprime dix ans plus tard dans une lettre à Dorothy Bussy, alors qu’il s’apprête à faire imprimer de manière anonyme un tirage à 21 exemplaires des deux premiers dialogues, réservés à quelques rares intimes et à lui-même, la plus grande partie de ces exemplaires ayant fini dans un tiroir : « La partie que je m’apprête à jouer est si dangereuse que je ne la puis gagner sans doute qu’en me perdant moi-même » (RR, 1172). De façon significative, la genèse et l’histoire éditoriale de Corydon racontent le long et douloureux cheminement de son auteur jusqu’au moment où il se décidera enfin à donner de son texte sous son nom une édition moins confidentielle au printemps 1924, décision qui n’est sans aucun doute nullement étrangère au fait que Proust ait lui-même fait paraître les deux tomes de son Sodome et Gomorrhe quelques mois plus tôt. On sait combien Gide se sentait révulsé par la figure des « sodomites » et des « invertis » proustiens, à laquelle il opposait celle du « pédéraste », qu’il revendiquait lui-même, convaincu que la vision proustienne de l’homosexualité ne pouvait qu’induire le public en erreur et perpétuer en son sein un jugement défavorable vis-à-vis des homosexuels.
Corydon est donc à replacer entre les deux figures tutélaires de l’homosexualité dans la littérature européenne du début du XXe siècle : Oscar Wilde et Marcel Proust. Entre 1895 et 1924, pour reprendre les mots de Gide, « combien d’arrêts, de réticences et de détours » (RR, 59) l’entreprise n’a-t-elle pas subi ! C’est que son auteur ne se place pas sur le plan de la littérature, même s’il s’inspire, dans son troisième dialogue notamment, des œuvres de Virgile, Longus, Montesquieu, Goethe, Gourmont et Barrès, pour ne citer qu’eux. Son discours s’inspire davantage de celui du naturaliste cherchant à intégrer l’homosexualité dans l’ordre des phénomènes présents dans la nature en tous lieux et à toutes les époques. Plus encore que la représentation littéraire que Proust vient de donner de l’homosexuel dans Sodome et Gomorrhe, c’est celle véhiculée par une littérature scientifique dégageant « une intolérable odeur de clinique » (RR, 73) que l’écrivain rejette (de fait, le personnage éponyme accusé de « penchants dénaturés » a fait de « brillantes » études de médecine, apprend-on dès la première page du texte). Mais Gide n’est pas médecin, et ses tentatives successives pour élaborer des démonstrations parfois fastidieuses ont pu décourager ses lecteurs les plus sensibles (« C’est que je m’adresse et veux m’adresser à la tête et non point au cœur », J1, 685), et encourager au contraire ses détracteurs les plus cyniques. Pour le lecteur contemporain, le style et l’approche de Corydon tiennent plus de la prose de Remy de Gourmont dans son Essai sur l’instinct sexuel que du discours des sciences sociales auxquelles on songerait de prime abord lorsqu’on aborde le sujet de l’homosexualité.
Gide reste pourtant avant tout un littéraire, un écrivain pétri de culture classique (Aristote, Platon, Diodore de Sicile, Plutarque figurent dans le texte) et, de bien des manières, le projet de Corydon trouve tout naturellement sa place dans sa trajectoire littéraire et dans la dimension autobiographique qui traverse son œuvre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’élaboration de Corydon suit de près celle de Si le grain ne meurt, et si l’histoire éditoriale des deux textes est intimement liée (la seconde édition anonyme de Corydon et celle tout aussi confidentielle des sept premiers chapitres de Si le grain ne meurt sortent toutes deux des presses de l’imprimerie Sainte-Catherine à Bruges au printemps 1920). Dans Corydon, Gide ne prétend pas « parler en spécialiste, mais en homme » (RR, 73). Convaincu que « tout homme porte en soi la forme entière de l’humaine condition » et que le lecteur se reconnaîtra dans le portrait qu’il fait de lui-même, ne procède-t-il pas de la même manière dans son autobiographie, et bien avant celle-ci, dans certains de ses récits comme L’Immoraliste ? Le ton du récit de Corydon se rapproche davantage de celui de Michel dans le récit de 1902 que de l’ironie de Paludes ou des Caves du Vatican. Du reste, Gide l’annonce clairement dans sa préface à l’édition de 1924 : « Je n’écris pas pour amuser et prétends décevoir dès le seuil ceux qui chercheront ici du plaisir, de l’art, de l’esprit ou quoi que ce soit d’autre enfin que l’expression la plus simple d’une pensée très sérieuse. » (RR, 60) C’est peut-être justement à cause de l’absence « du plaisir, de l’art, de l’esprit » qui caractérisent si souvent les œuvres de Gide, et de la volonté affichée par l’auteur d’y paraître au contraire le plus « sérieux » possible, que Corydon peut décevoir les lecteurs contemporains, qui lui préféreront la représentation grotesque, certes, mais qu’on peut néanmoins juger divertissante d’un Charlus et d’un Jupien chez Proust.
Peut-être Gide avait-il saisi toute la difficulté de sa tâche dans Corydon : démontrer de façon quasi scientifique le caractère éminemment naturel de l’homosexualité, ou en tout cas d’une certaine forme d’homosexualité, celle du pédéraste attiré par de jeunes adolescents (on s’étonnera d’ailleurs de la répugnance de Gide à l’égard des « sodomites » et des « invertis »). Si le narrateur ne trouve pas chez Corydon « ces marques d’efféminement que les spécialistes retrouvent à tout ce qui touche les invertis », c’est que Corydon est pédéraste (RR, 63). L’idiosyncrasie sexuelle de l’écrivain a sans aucun doute joué un rôle non négligeable dans l’image « socratique » ou « virgilienne » que Gide a donné de l’homosexualité dans Corydon. C’est aussi ce qui explique que le texte ne soit pas toujours vu d’un très bon œil par les représentants des études de genre et des queer studies, qui jugent la position de Gide à la fois restrictive et intolérante, et qui lui préfèrent de loin la vision moins discriminatoire d’un Proust dans Sodome et Gomorrhe ou d’un Genet dans Querelle de Brest.
Dans Corydon, le lecteur sera parfois surpris d’entendre le personnage éponyme reprocher à l’homosexualité « ses dégénérés, ses viciés et ses malades » (RR, 74). Curieuse manière de prendre la défense de l’homosexualité ! Mais Gide n’échappe pas toujours aux préjugés de son époque (comment le pourrait-il ?), et, aussi surprenant que cela puisse paraître, on trouve dans son œuvre des traces d’homophobie refoulée.
Là n’est pas, toutefois, le plus intéressant : ce qui retient l’attention, c’est le fait que Corydon soit entièrement constitué d’un dialogue sur le livre que le lecteur est censé lire un jour, et dont il ne lira en fait que l’avant-texte. Si l’on songe inévitablement à Paludes et aux Faux-Monnayeurs, ce procédé laisse surtout entendre que le plaidoyer gidien en faveur de la pédérastie est en fait inachevé, Gide en étant resté aux prolégomènes : en d’autres termes, Corydon dénoncerait (et tenterait d’excuser) ses propres faiblesses. Tout au long des quatre dialogues qui composent ce symposium moderne, Corydon et son interlocuteur évoquent dans le détail un livre dont toutes les composantes ont certes été longuement pensées et élaborées (jusqu’aux moindres éléments du paratexte, semble-t-il : « ce sont deux phrases que je veux épingler en épigraphe », RR, 78), mais qui reste encore à écrire. Ainsi Corydon est-il à la fois un livre fini (ces interviews imaginaires que nous avons entre les mains) et un livre à venir. Échappant à l’accomplissement et au pouvoir irrévocable et réducteur des mots imprimés sur le papier, ce work-in-progress refuse d’être figé dans le langage, de même que l’identité homosexuelle résiste à toute cristallisation verbale. Dans Si le grain ne meurt, l’écrivain décrit cette double résistance des mots et de la chose homosexuelle : « Lorsque ensuite je fus mieux instruit, […] j’ai pu sourire des immenses tourments que de petites difficultés me causaient, appeler par leur nom des velléités indistinctes encore et qui m’épouvantaient parce que je n’en discernais point le contour » (VS, 269). Corydon conserve des traces de cette difficulté à cerner les contours d’une identité transgressive. La prose sinueuse de Gide peut se lire comme la manifestation d’un processus que les psychologues spécialistes des questions d’identité sexuelle désignent sous le nom de fluidité sexuelle (« sexual fluidity »), et montre combien l’univers de la sexualité échappe aux structures du langage parlé et écrit. En ce sens, Corydon demeure très proche des œuvres les plus représentatives de Gide, celles où le grand écrivain se montre assailli par le doute, disant une chose puis son contraire, pesant le pour et le contre, tentant d’exprimer dans ses moindres détails toute la complexité de l’âme humaine. Dans la langue même de Corydon, cette dynamique se trahit souvent par l’utilisation simultanée du futur (« dans mon livre, je laisserai [ma pensée] tout naturellement découler des prémisses que nous avons tout à l’heure posées », RR, 124) et du conditionnel présent (« je voudrais, dans mon livre, ne recourir à la vertu qu’en dernier ressort », RR, 128).
Ainsi, si le propos de Gide dans Corydon a bel et bien vieilli avec le temps, et semble dépassé depuis les années 1960, la forme du texte demeure d’une étonnante modernité, à l’image des textes les plus audacieux de l’écrivain. Au tout début du troisième dialogue, Corydon note que « l’importance d’un nouveau système proposé, d’une nouvelle explication de certains phénomènes, ne se mesure point uniquement à son exactitude, mais bien aussi, mais bien surtout, à l’élan qu’elle fournit à l’esprit pour de nouvelles découvertes, de nouvelles constatations... » (RR109). Si les propos de Gide dans Corydon ne sont pas d’une exactitude sans faille, tant s’en faut, au moins auront-ils fourni à l’esprit des générations suivantes un élan indispensable pour progresser sur la voie de la libération sexuelle.
Frédéric CANOVAS
Bibliographie raisonnée
Ahlstedt, Eva, André Gide et le débat sur l’homosexualité, Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis, 1994.
Amadieu Jean-Baptiste, « Corydon de Gide devant les tribunaux catholiques », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, 2012, p.93-119.
Canovas, Frédéric, « De l’allusion à l’aveu : genèse d’un vice », dans Bulletin des Amis d’André Gide, no 150, avril-juin 2006, p. 203-233.
Courouve, Claude, « Les vicissitudes de Corydon », dans André Gide, Corydon, Paris, Gallimard, « folio », 1991.
Dollimore, Jonathan, Sexual Dissidence : Augustine to Wilde, Freud to Foucault, New York/Oxford, Oxford University Press, 1991.
El Sokati Chahira Abdallah, André Gide au miroir de la critique : Corydon entre œuvre et manifeste, thèse de doctorat en littérature soutenue à l'Université Paris-Est en 2011 sous la direction de François Dachet.
Goulet Alain. « Le dossier préparatoire de Corydon», Bulletin des Amis d'André Gide n° 155, juillet 2007, p.392-439.
Goulet Alain, «Lettres recueillies par André Gide dans son dossier:" Corydon "», Bulletin des Amis d'André Gide n°155, juillet 2007, p. 442-450.
Goulet, Alain, Notice et notes de Corydon, dans André Gide, Romans et récits, œuvres lyriques et dramatiques, vol. 1, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2009, p. 1162-1200.
Goulet, Alain, Notice de Corydon, dans Pierre Masson et Jean-Michel Wittmann (éds.), Dictionnaire Gide, Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 102-104.
Goulet, Alain, Les Corydon d’André Gide, Paris, Orizons, 2014.
Legrand, Justine, André Gide : de la perversion au genre sexuel, Paris, Orizons, 2012.
Lucey, Michael, Gide’s Bent : Sexuality, Politics, Writing, New York/Oxford, Oxford University Press, 1995.
Masson Pierre, « Corydon, texte littéraire ? », Bulletin des Amis d'André Gide, n°s 189-190, printemps 2016, p. 71-86.
Moutote, Daniel, « Corydon en 1918 », dans Bulletin des Amis d’André Gide, no 78-79, avril-juin 1988, p. 9-24.
Nazier, François, L’Anti Corydon (essai sur l’inversion sexuelle), Paris, Éditions du siècle, 1924.
Nemer, Monique, Corydon citoyen : essai sur André Gide et l’homosexualité, Paris, Gallimard, 2006.
Pollard, Patrick, André Gide. Homosexual Moralist, New Haven/London, Yale University Press, 1991.
Porché, François, L’Amour qui n’ose pas dire son nom (Oscar Wilde), Paris, Grasset, 1927.
Roulin Jean-Marie, « La camera oscura d’André Gide, ou l’écriture du plaisir homosexuel », Studi Francesi [Online], 170 (LVII | II) | 2013. (version papier p. 385-395).
Segal, Naomi, André Gide : Pederasty and Pedagogy, London, Clarendon Press, 1998.