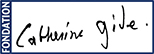Le 30 avril 2019 a eu lieu la cinquième rencontre du cycle de conférences / performances « Gide Remix », organisé par l’Université de Haute-Alsace. La soirée s’est déroulée dans les serres de la Pépinière municipale, exceptionnellement ouvertes au public. L’entretien, animée par Martina Della Casa, a été suivi par une promenade ponctuée de lectures.
Un compte-rendu de la soirée est disponible sur le site de la Fondation Catherine Gide (ici).
Pour prolonger la réflexion...
BASTIDE, Roger, « André Gide jardinier », in Anatomie d’André Gide [1972], Paris, L’Harmattan, 2006, p. 25-37.
KRZYWKOWSKI, Isabelle, « La source et le marécage : le jardin dans les récits d’André Gide », Université Grenoble Alpes, La Réserve – Archives des articles en libre accès.
MASSON, Pierre, « Production – reproduction : l’intertextualité comme principe créateur dans l’œuvre d’André Gide », in Raimund Thies et Hans T. Siepe (éds), Le Plaisir de l’intertexte, Actes du colloque de l’Université de Duisburg, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1986, p. 209-226.
MASSON, Pierre, « Les trois grains d’André Gide », Bulletin des Amis d’André Gide, numéro 131-132, octobre 2001, p. 407-419.
MASSON, Pierre, « L’arbre jusqu’aux racines ou la Querelle du peuplier », Bulletin des Amis d’André Gide, numéro 145, janvier 2005, p. 23-28.
MICHEL, Eugène, « “Un arbre qui marche...” : approche de la botanique chez Goethe et Gide », Bulletin des Amis d’André Gide, numéro 126-127, avril 2000, p. 325-329.
MOUTOTE, Daniel, Les Images végétales dans l’œuvre d’André Gide, Paris, Presses Universitaires de France, 1970.
REID, Victoria, « Scientific Curiosity », in André Gide and Curiosity, Amsterdam & New York, Rodopi, 2009, p. 143 et sq.
TILBY, Michael, « Gide et le désordre du récit : fiction et botanique dans Isabelle », Bulletin des Amis d'André Gide, numéro 131-132, juillet-octobre 2001, p. 523-549.
WITTMANN, Jean-Michel « À l’ombre du platane de Taine », in Gide politique. Essai sur Les Faux-monnayeurs, Paris, Classiques Garnier, 2009, p. 87-118.
À feuilleter...
Les Jardins d’André Gide, texte de Mic CHAMBLAS-PLOTON, photographies de Jean-Baptiste LEROUX, avec une préface de Claude MARTIN, Paris, Éditions du Chêne, 1998.
Lectures
Les Caves du Vatican (1914)
Mme Amédée Fleurissoire, née Péterat, sœur cadette de Véronique Armand-Dubois et de Marguerite de Baraglioul, répondait au nom baroque d’Arnica. Philibert Péterat, botaniste assez célèbre, sous le Second Empire, par ses malheurs conjugaux, avait, dès sa jeunesse, promis des noms de fleurs aux enfants qu’il pourrait avoir. Certains amis trouvèrent un peu particulier le nom de Véronique dont il baptisa le premier ; mais lorsqu’au nom de Marguerite, il entendit insinuer qu’il en rabattait, cédait à l’opinion, rejoignait le banal, il résolut, brusquement rebiffé, de gratifier son troisième produit d’un nom si délibérément botanique qu’il fermerait le bec à tous les médisants.

Peu après la naissance d’Arnica, Philibert, dont le caractère s’était aigri, se sépara d’avec sa femme, quitta la capitale et s’alla fixer à Pau. L’épouse s’attardait à Paris l’hiver, mais aux premiers beaux jours regagnait Tarbes, sa ville natale, où elle recevait ses deux aînées dans une vieille maison de famille. Véronique et Marguerite mi-partissaient l’année entre Tarbes et Pau. Quant à la petite Arnica, méconsidérée par ses sœurs et par sa mère, un peu niaise, il est vrai, et plus touchante que jolie, elle demeurait, été comme hiver, près du père.
La plus grande joie de l’enfant était d’aller herboriser avec son père dans la campagne ; mais souvent le maniaque, cédant à son humeur chagrine, la plantait là, partait tout seul pour une énorme randonnée, rentrait fourbu, et sitôt après le repas, se fourrait au lit sans faire à sa fille l’aumône d’un sourire ou d’un mot. Il jouait de la flûte à ses heures de poésie, rabâchant insatiablement les mêmes airs. Le reste du temps il dessinait de minutieux portraits de fleurs.
Une vieille bonne, surnommée Réséda, qui s’occupait de la cuisine et du ménage, avait la garde de l’enfant ; elle lui enseigna le peu qu’elle connaissait elle-même. À ce régime, Arnica savait à peine lire à dix ans. Le respect humain avertit enfin Philibert : Arnica entra en pension chez Mme Veuve Semène qui inculquait des rudiments à une douzaine de fillettes et à quelques très jeunes garçons.
Arnica Péterat, sans défiance et sans défense, n’avait jamais imaginé jusqu’à ce jour que son nom pût porter à rire. Elle eut, le jour de son entrée dans la pension, la brusque révélation de son ridicule ; le flot de moqueries la courba comme une algue lente ; elle rougit, pâlit, pleura ; et Mme Semène, en punissant d’un coup toute la classe pour tenue indécente, eut l’art maladroit de charger aussitôt d’animosité un esclaffement d’abord sans malveillance.
Longue, flasque, anémique, hébétée, Arnica restait les bras ballants au milieu de la petite classe, et quand Mme Semène indiqua : « Sur le troisième banc de gauche, mademoiselle Péterat », la classe repartit de plus belle en dépit des admonestations.
Pauvre Arnica ! la vie n’apparaissait déjà plus devant elle que comme une morne avenue bordée de quolibets et d’avanies.
Les Nourritures terrestres (1897)
Nathanaël, je te raconterai les plus beaux jardins que j’ai vus :
À Florence, on vendait des roses : certains jours la ville tout entière embaumait. Je me promenais chaque soir aux Cascines et le dimanche aux jardins Boboli sans fleur.

Détail de la fontaine de Narcisse dans le parc des Cascines à Florence
(© Les Jardins d’André Gide)
À Séville, il y a, près de la Giralda, une ancienne cour de mosquée ; des orangers y poussent par places, symétriques ; le reste de la cour est dallé ; les jours de grand soleil, on n’y a qu’une petite ombre restreinte ; c’est une cour carrée, entourée de murs ; elle est d’une grande beauté ; je ne sais pas t’expliquer pourquoi.
Hors de la ville, dans un énorme jardin clos de grilles, croissent beaucoup d’arbres des pays chauds ; je n’y suis pas entré, mais, à travers les grilles, j’ai regardé ; j’ai vu courir des pintades et j’ai pensé qu’il y avait là beaucoup d’animaux apprivoisés.
Que te dirais-je de l’Alcazar ? jardin semblant de merveille persane ; je crois, en t’en parlant, que je le préfère à tous les autres. J’y pense, en relisant Hafiz :
Apportez-moi du vin
Que je tache ma robe,
Car je chancelle d’amour
Et l’on m’appelle sage.
Des jeux d’eaux sont préparés dans les allées ; les allées sont dallées de marbre, bordées de myrtes et de cyprès. Des deux côtés sont des bassins de marbre, où les amantes du roi se lavaient. On n’y voit d’autres fleurs que des roses, des narcisses et des fleurs de laurier. Au fond du jardin, il y a un arbre gigantesque, où l’on se figure un bulbul épinglé. [...]
À Grenade, les terrasses du Généraliffe, plantées de lauriers-roses, n’étaient pas fleuries lorsque je les vis ; ni le Campo Santo de Pise ; ni le petit cloître de Saint-Marc, que j’aurais souhaité plein de roses. Mais à Rome, le Monte Pincio, je l’ai vu dans la plus belle saison. Durant les après-midi accablantes, on y venait chercher de la fraîcheur. Demeurant auprès, je m’y promenais chaque jour. J’étais malade et ne pouvais penser à rien ; la nature me pénétrait ; aidé par un trouble des nerfs, je ne sentais parfois plus à mon corps de limites ; il se continuait plus loin ; ou parfois, voluptueusement, devenait poreux comme un sucre ; je fondais. [...] Ô terrasses ! Terrasses, d’où l’espace s’est élancé. Ô navigation aérienne !…
J’aurais voulu, la nuit, rôder dans les jardins Farnèse ; mais on n’y laisse pas pénétrer. Admirable végétation sur ces ruines dissimulées.
À Naples, il y a des jardins bas qui suivent la mer comme un quai et laissent entrer le soleil ;
à Nîmes, la Fontaine, pleine d’eaux claires canalisées ;
à Montpellier, le jardin botanique. Je me souviens qu’avec Ambroise, un soir, comme aux jardins d’Académus, nous nous assîmes sur une tombe ancienne, qui y est tout entourée de cyprès ; et nous causions lentement en mâchant des pétales de roses. [...]
À Tunis, il n’y a pas d’autre jardin que le cimetière. À Alger, au jardin d’Essai (des palmiers de toute espèce), j’ai mangé des fruits que je n’avais auparavant jamais vus. Et de Blidah ! Nathanaël, que te dirai-je ?
Ah ! douce est l’herbe du Sahel ; et tes fleurs d’orangers ! et tes ombres ! suaves les odeurs de tes jardins. Blidah ! Blidah ! petite rose ! au début de l’hiver, je t’avais méconnue. Ton bois sacré n’avait de feuilles que celles qu’un printemps ne renouvelle pas ; et tes glycines et tes lianes semblaient des sarments pour la flamme. La neige descendue des montagnes t’approchait ; je ne pouvais me réchauffer dans ma chambre, et moins encore dans tes jardins pluvieux. [...]
Blidah ! Blidah ! fleur du Sahel ! petite rose ! Je t’ai vue tiède et parfumée, pleine de feuilles et de fleurs. La neige de l’hiver avait fui. Dans ton jardin sacré luisait mystiquement ta mosquée blanche et la liane ployait sous les fleurs. Un olivier disparaissait sous les guirlandes qu’une glycine lui faisait. L’air suave apportait le parfum qui s’élevait des fleurs d’orangers et même des mandariniers grêles embaumaient. Du plus haut de leurs hautes branches, les eucalyptus délivrés laissaient tomber leur vieille écorce ; elle pendait, protection usée, comme un habit que le soleil rend inutile, comme ma vieille morale qui ne valait que pour l’hiver.

(© Les Jardins d’André Gide)
Jardins de Biskra.
Le temps gris d’aujourd’hui ; mimosas parfumés. Tiédeur mouillée. Des gouttes épaisses ou larges, flottantes, et comme en formation dans l’air… Elles s’arrêtent aux feuilles, les chargent, puis tombent brusquement.
...Je me souviens d’une pluie d’été ; – mais était-ce encore de la pluie ? – ces gouttes tièdes qui tombèrent, si larges et pesantes, sur ce jardin de palmes et de jour vert et rose, si lourdes que des feuilles et des fleurs et des branches roulèrent comme un don amoureux de guirlandes défaites à foison sur les eaux. Les ruisseaux entraînaient les pollens pour des fécondations lointaines ; leurs eaux étaient troubles et jaunes. Dans les bassins les poissons se pâmaient. On entendait au ras de l’eau l’éclosion de la bouche des carpes.
Avant la pluie, le vent du midi qui râlait avait enfoncé dans la terre une très profonde brûlure, et les allées maintenant s’emplissaient de vapeur sous les branches ; les mimosas ployaient, comme abritant les bancs où s’étalait la fête. – C’était un jardin de délices ; et les hommes vêtus de lainages, les femmes en haïks rayés, attendaient que l’humidité les pénétrât. Ils restaient comme auparavant sur les bancs, mais toutes les voix s’étaient tues, et chacun écoutait les gouttes de l’averse, laissant l’eau, passagère au milieu de l’été, alourdir les étoffes et laver les chairs proposées. – La moiteur de l’air, l’importance des feuilles étaient telles que je restais assis sur ce banc auprès d’eux, sans résistance pour l’amour. – Et quand, la pluie passée, les branches seules ruisselèrent, alors chacun ôtant ses souliers, ses sandales, palpa de ses pieds nus cette terre mouillée, dont la mollesse était voluptueuse.
L’Immoraliste (1902)
Marceline, cependant, qui voyait, avec joie ma santé enfin revenir, commençait depuis quelques jours à me parler des merveilleux vergers de l’oasis. Elle aimait le grand air et la marche. La liberté que lui valait ma maladie lui permettait de longues courses dont elle revenait éblouie ; jusqu’alors elle n’en parlait guère, n’osant m’inciter à l’y suivre et craignant de me voir m’attrister au récit de plaisirs dont je n’aurais pu jouir déjà. Mais, à présent que j’allais mieux, elle comptait sur leur attrait pour achever de me remettre. Le goût que je reprenais à marcher et à regarder m’y portait. Et dès le lendemain nous sortîmes ensemble.
Elle me précéda dans un chemin bizarre et tel que dans aucun pays je n’en vis jamais de pareil. Entre deux assez hauts murs de terre, il circule comme indolemment ; les formes des jardins que ces hauts murs limitent, l’inclinent à loisir ; il se courbe ou brise sa ligne ; dès l’entrée, un détour nous perd ; on ne sait plus ni d’où l’on vient, ni où l’on va. L’eau fidèle de la rivière suit le sentier, longe un des murs ; les murs sont faits avec la terre même de la route, celle de l’oasis entière, une argile rosâtre ou gris tendre, que l’eau rend un peu plus foncée, que le soleil ardent craquelle et qui durcit à la chaleur, mais qui mollit dès la première averse et forme alors un sol plastique où les pieds nus restent inscrits. – Par-dessus les murs, des palmiers. À notre approche, des tourterelles y volèrent. Marceline me regardait.
J’oubliais ma fatigue et ma gêne. Je marchais dans une sorte d’extase, d’allégresse silencieuse, d’exaltation des sens et de la chair. À ce moment, des souffles légers s’élevèrent ; toutes les palmes s’agitèrent et nous vîmes les palmiers les plus hauts s’incliner ; – puis l’air entier redevint calme, et j’entendis distinctement, derrière le mur, un chant de flûte. – Une brèche au mur ; nous entrâmes.
C’était un lieu plein d’ombre et de lumière ; tranquille, et qui semblait comme à l’abri du temps ; plein de silences et de frémissements, bruit léger de l’eau qui s’écoule, abreuve les palmiers, et d’arbre en arbre fuit, appel discret des tourterelles, chant de flûte dont un enfant jouait. Il gardait un troupeau de chèvres ; il était assis, presque nu, sur le tronc d’un palmier abattu ; il ne se troubla pas à notre approche, ne s’enfuit pas, ne cessa qu’un instant de jouer.
Je m’aperçus, durant ce court silence, qu’une autre flûte au loin répondait. Nous avançâmes encore un peu, puis :
« Inutile d’aller plus loin, dit Marceline ; ces vergers se ressemblent tous ; à peine, au bout de l’oasis deviennent-ils un peu plus vastes… » Elle étendit le châle à terre :
« Repose-toi. »
Combien de temps nous y restâmes ? je ne sais plus ; – qu’importait l’heure ? Marceline était près de moi ; je m’étendis, posai sur ses genoux ma tête. Le chant de flûte coulait encore, cessait par instants, reprenait ; le bruit de l’eau… Par instants une chèvre bêlait. Je fermai les yeux ; je sentis se poser sur mon front la main fraîche de Marceline ; je sentais le soleil ardent doucement tamisé par les palmes ; je ne pensais à rien ; qu’importait la pensée ? je sentais extraordinairement.
Et par instants, un bruit nouveau ; j’ouvrais les yeux ; c’était le vent léger dans les palmes ; il ne descendait as jusqu’à nous, n’agitait que les palmes hautes…

(© Fondation Catherine Gide)
Voyage au Congo (1926)
Levés avant cinq heures. Thé sommaire. On plie bagages. Sur l’arène, derrière la maison, sont groupés nos porteurs (60 hommes, plus un milicien, un guide indigène, nos deux boys et le cuisinier ; plus encore trois femmes, accompagnant le milicien et le guide). Le chef est venu nous dire adieu. Clair de lune brumeux. Nous partons dans la douteuse clarté d’avant l’aube, précédant le gros de la troupe, avec nos boys, nos tipoyeurs, le guide, le garde, et les porteurs de nos sacs.
L’interminable forêt met à l’épreuve notre inépuisable patience. [...] Forêt des plus monotones, et très peu exotique d’aspect. Elle ressemblerait à telle forêt italienne, celle d’Albano par exemple, ou de Némi, n’était parfois quelque arbre gigantesque, deux fois plus haut qu’aucun de nos arbres d’Europe, dont la cime s’étale loin au-dessus des autres arbres, qui, près de lui, paraissent réduits en taillis. Les troncs de ces derniers, à demi couverts de mousse, semblent des troncs de chênes-verts, ou de lauriers. Les petites plantes vertes qui bordent la route rappellent nos myrtilles ; d’autres, les « herbes à Circé » ; tout comme, dans le marigot d’avant-hier, des plantes d’eau rappelaient nos épilobes et nos balsamines du Nord. Nos châtaignes ne sont pas moins bizarres, pas moins belles que ces graines dont on ne voit à terre que les cosses velues. Pas de fleurs. [...] À l’extrémité du parcours, le terrain, jusqu’alors parfaitement plan, dévale faiblement jusqu’à une petite rivière peu profonde, ombragée ; l’eau claire coule sur un lit de sable blanc. Nos porteurs se baignent.

Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine,
Dist. RMN-Grand Palais / Marc Allégret